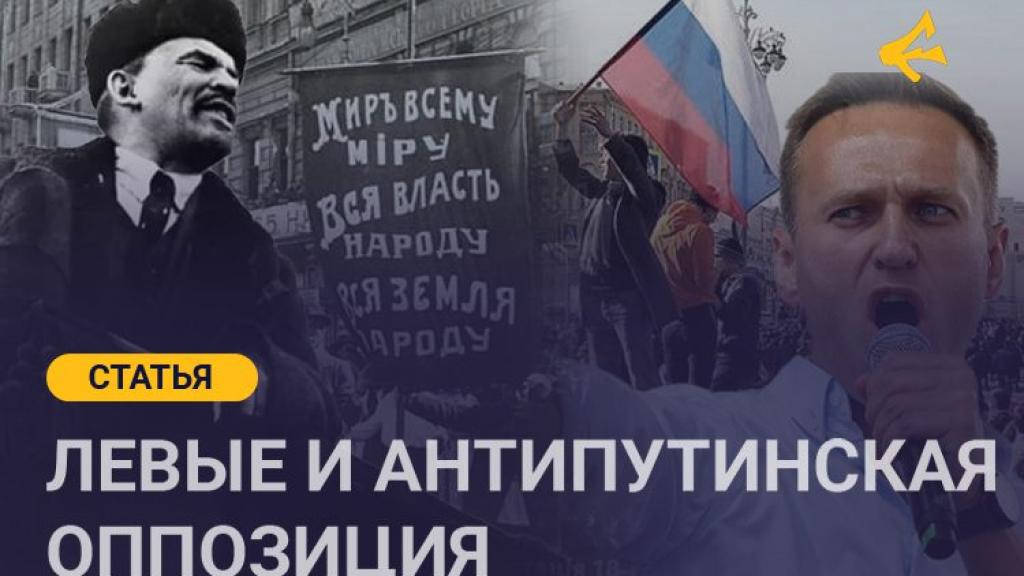 Par Alexey Sakhnin et Liza Smirnova
Par Alexey Sakhnin et Liza Smirnova
La gauche anticapitaliste russe n’est pas parvenue à s’organiser en tant que force politique indépendante avant le début de l’«opération militaire spéciale» [1]. Pendant des années, elle a été déchirée entre deux géants: le Parti communiste de la Fédération de Russie (PCFR) d’un côté et l’opposition libérale de l’autre. Le PCFR détenait une «autorisation» pour participer à la vie politique électorale, il pouvait fournir les ressources organisationnelles nécessaires et offrait au moins une certaine protection contre la répression arbitraire. Mais cette coopération avait un prix: la direction du parti était profondément imbriquée dans le régime au pouvoir. Elle voyait la garantie de préserver sa position non pas dans la mobilisation de larges masses sociales, mais dans des accords secrets avec le Kremlin ou les autorités régionales. En conséquence, les dirigeants du parti ont bloqué les campagnes de protestation trop efficaces de leurs alliés de gauche et se sont montrés réticents à les laisser participer aux élections.
La coopération avec l’opposition libérale avait d’autres implications. Les libéraux pouvaient parfois se montrer intransigeants dans leur opposition à Poutine, mais leur programme était étroitement lié aux privilèges d’une élite restreinte et aliénaient la majorité pauvre de la population. Ni leurs ressources financières ni leur puissant réseau de médias d’opposition ne permettaient à l’opposition libérale de gagner un soutien au-delà de la classe moyenne. La seule tentative pour sortir de ce moule a été le «virage à gauche» d’Alexei Navalny [2] en 2018-2021, lorsqu’il a commencé à aborder les questions de justice sociale et d’inégalité. Cela a eu un effet: la popularité de Navalny a augmenté. Mais la lutte pour obtenir un large soutien s’est heurtée à des contradictions. En 2018, les autorités ont mené une réforme des retraites extrêmement impopulaire, relevant l’âge de la retraite. Le mouvement de Navalny a tenté de mener les protestations massives contre cette mesure, même si son propre programme stipulait explicitement la nécessité de relever l’âge de la retraite.
Au début de la guerre, l’opposition extraparlementaire bénéficiait du soutien de 15 à 20% des citoyens et citoyennes. La grande majorité dépolitisée du pays restait méfiante, principalement par crainte d’un «nouveau 1990», c’est-à-dire d’une nouvelle vague de réformes néolibérales qui avaient entraîné des inégalités catastrophiques. C’est précisément cette crainte qui a permis au régime de conserver la confiance des Russes et même un certain soutien populaire.
La gauche qui soutenait Navalny est également devenue otage de cette crainte. Certains ont réussi: avec le soutien des libéraux et grâce à la mobilisation de l’électorat de la classe moyenne, certains militants de gauche ont remporté des sièges dans les parlements locaux. Mais ce faisant, ils ont souvent perdu à la fois leur identité politique et la possibilité de mobiliser le soutien des classes populaires.
Au début de la guerre
Au début de la guerre, de nombreux responsable de gauche dépendants du PCFR l’ont soutenue ou sont restés silencieux et passifs. Les députés qui ont ouvertement condamné le début des opérations militaires en Ukraine ont été expulsés du parti et soumis à la répression. L’opposition extraparlementaire a réussi à organiser des rassemblements de protestation de masse dans les grandes villes. Les militants de gauche opposants à la guerre, notamment la coalition Socialistes contre la guerre (voir le site Green Left, «Socialist Against the War Coalition», 3 mars 2022), ont activement participé à ces manifestations, mais la mobilisation s’est appuyée presque exclusivement sur la base sociale traditionnelle de l’opposition: la jeunesse urbaine et la classe moyenne des grandes villes.
Les manifestations ont été brutalement réprimées. La vague de répression a déclenché une émigration massive des militants de l’opposition: jusqu’à un million de personnes ont quitté le pays en 2022. Le noyau dur du mouvement de protestation anti-Poutine a été écrasé. Au-delà de la classe moyenne, l’opposition avait peu de partisans, et ceux qu’elle avait étaient totalement désorganisés. Cette base sociale étroite a joué un tour cruel aux opposants à Poutine.
Nouveau mécontentement
En détruisant l’ancien rapport de forces, la guerre a créé de nouvelles contradictions et de nouveaux conflits sociaux. La conscription forcée a provoqué une explosion de colère et a conduit le régime au bord de la crise. Même les sondeurs officiels ont enregistré une baisse de la cote de popularité de Poutine. Au cours du seul premier mois de la mobilisation militaire, plus de 20 incidents armés ont eu lieu dans tout le pays. Les soldats ont frappé des officiers, arrêté des trains qui les transportaient vers le front et déserté leurs unités de manière organisée. Cela a contraint les autorités à abandonner la conscription obligatoire au profit d’un système de recrutement de mercenaires, qui ne permet pas d’augmenter rapidement les effectifs de l’armée ni la production militaire. Le régime a été contraint d’accepter ce «compromis», car une nouvelle vague de mobilisation massive pourrait déclencher une crise sociopolitique profonde.
Même aujourd’hui, les difficultés de la vie militaire se font cruellement sentir dans les tranchées. Légalement, il est impossible de résilier un contrat militaire avant la fin de la guerre, ce qui a entraîné une augmentation du nombre de déserteurs. Selon des chercheurs de l’OSINT (Open-source intelligence), à la fin de 2024, pas moins de 50 000 soldats avaient déserté leurs unités. Plus de 20 000 individus ont fait l’objet de poursuites pénales pour ces infractions militaires.
La politique de keynésianisme militaire, associée à une pénurie de main-d’œuvre, a apporté des avantages tangibles à la classe ouvrière russe. Les salaires dans l’industrie ont considérablement augmenté, devenant un facteur important de maintien de la stabilité sociale. Mais aujourd’hui, la croissance des salaires a pris fin et l’inflation élevée érode progressivement les gains des travailleurs et travailleuses, une évolution qui menace également de déclencher une nouvelle vague de conflits sociaux.
Dans tout le pays, le désir de paix et de retour à la vie civile grandit. Des sondages indiquent qu’en mai 2025, 61% des citoyens étaient favorables à un début rapide de négociations de paix, tandis que seulement 30% soutenaient la poursuite des hostilités (et ce, malgré le fait que de nombreux citoyens opposés à la guerre ne participent pas à ces sondages en raison de la censure et de la répression, tandis que beaucoup d’autres donnent des réponses «socialement acceptables»). Le fait que le régime soit inapte à conclure la paix, même dans des conditions internationales favorables, renforce le mécontentement face à la prolongation des hostilités. Cependant, l’ancienne opposition est totalement incapable de mobiliser ce mécontentement croissant.
Emigration anti-guerre en faveur de la «victoire jusqu’au bout»
Dans le contexte de la guerre, presque tous les dirigeants de l’opposition ont pris le parti des autorités ukrainiennes et de leurs alliés occidentaux, soutenant le programme qu’ils ont formulé: retour aux frontières de 1991, démantèlement du régime politique actuel en Russie par les vainqueurs et leurs alliés, et paiement de réparations par tous les citoyens russes. «Si vous êtes actionnaire d’une société par actions, c’est-à-dire citoyen d’un pays, même si vous n’êtes pas d’accord avec la direction, vous portez toujours votre part de responsabilité», a déclaré, par exemple, Vladimir Milov [3], un proche collaborateur de Navalny et auteur de son programme économique «Nouvelle Russie».
Plus important encore, la mise en œuvre de ce programme nécessite une escalade de la guerre par un soutien militaire inconditionnel à l’armée ukrainienne, pouvant aller jusqu’à la défaite militaire de la Russie. «Si vous voulez aider la Russie démocratique, sauvez l’Ukraine de Poutine. C’est exactement en votre pouvoir», a déclaré l’ancien prisonnier politique Ilya Yashin [4] devant le Parlement européen le 5 juin 2025.
Pour les intellectuels libéraux proches de la Fondation anti-corruption-FBK [5] et de Yulia Navalnaya [6], les soldats russes ne sont qu’une menace pour la Russie «démocratique et européenne» de demain. Ils ne sont pas considérés comme les agents d’un changement nécessaire, mais comme des «personnes aigries et moralement déformées» qui ont besoin d’être surveillées et rééduquées. «Nous devrons faire tout notre possible pour que les personnes démobilisées de l’armée ou renvoyées des «services de sécurité» ne forment pas des gangs et ne commencent pas à créer des groupes criminels», a déclaré l’historienne Tamara Eidelman [7] lors d’un forum Navalnaya [8].
Yulia Navalnaya souligne que, par le passé, l’opposition comptait sur le soutien de l’administration américaine et qu’elle se tourne désormais vers l’Union européenne pour obtenir de l’aide. Cela correspond parfaitement au discours des autorités russes, qui présentent les personnalités de l’opposition comme faisant partie de l’appareil politico-militaire d’un ennemi extérieur. La position actuelle de l’opposition libérale renforce cette image et pousse les Russes à se rallier au gouvernement actuel.
Yulia Navalnaya affirme représenter «l’opposition unie». C’est une exagération, mais elle repose sur certains éléments. Deux forums de l’«opposition unie» ont eu lieu à Vilnius [capitale de la Lituanie], auxquels ont également participé certains politiciens de gauche. «Pour la gauche, il est tout à fait logique d’avoir une conversation amicale avec ceux qui se trouvent à notre droite», a expliqué Mikhail Lobanov [9] à propos de sa participation à un tel forum. «La communauté militante se déplace vers la gauche. En ne nous opposant pas à l’opposition libérale, nous créons des canaux par lesquels les militants peuvent migrer vers la gauche»!
Pour la gauche, la lutte pour l’influence au sein du milieu restreint de l’opposition en exil peut permettre d’accéder à certaines ressources et aux médias, mais elle isole aussi considérablement l’opposition émigrée de ceux qui sont restés en Russie. Le soutien intérieur à l’opposition est tombé à un niveau minimal. Les sondages enregistrent une désillusion croissante à l’égard des structures du FBK, même parmi les émigrés. L’un des derniers politiciens de l’opposition encore en Russie, Lev Shlosberg [10], dresse un sombre bilan: «Le «parti du sang des autres» [11] a atteint un nouveau niveau de bassesse… Il est évident qu’ils espèrent revenir en Russie sous la protection des chars d’un autre pays. Un politicien cesse d’être un politicien de son propre pays lorsqu’il commence à souhaiter la mort de ses concitoyens.»
La coopération entre les émigrés de gauche et les dirigeants libéraux démoralise leurs propres partisans en Russie. Beaucoup d’entre eux ne comprennent pas pourquoi leurs camarades continuent de placer leurs espoirs dans une alliance avec une opposition libérale en faillite, misant sans cesse sur une hypothétique scission au sein des élites et sur un pacte avec celles-ci, au lieu de présenter au pays leur propre visage et leur propre stratégie.
Stratégie
Une alliance avec l’opposition libérale, désormais isolée de la Russie et transformée en une petite faction du «parti de la guerre» occidental, est un choix catastrophique pour la gauche. Aucun succès dans la recherche de nouveaux effectifs, de nouvelles ressources ou de l’attention des médias ne peut compenser une mort politique. Pour remplir sa véritable mission – devenir la voix de millions de Russes lassés par la guerre, la répression et les inégalités –, la gauche a besoin d’une stratégie claire et convaincante. Les grandes lignes de cette stratégie peuvent déjà être esquissées.
- Au premier plan doit figurer la revendication d’une paix immédiate, et non d’une victoire militaire (pour ceux qui sont condamnés à mourir dans les tranchées, peu importe désormais que ce soit la victoire de l’Occident ou celle de la Russie). Si la classe dirigeante continue de se montrer incapable d’apporter la paix au peuple, la revendication de la fin des actions militaires fratricides deviendra le catalyseur le plus puissant de la mobilisation sociale.
- Pour défendre la paix entre les peuples frères, les militant·e·s de gauche russes ont besoin d’alliés parmi les Ukrainiens. A partir de la base, nous pouvons faire ce que les politiciens ne peuvent pas faire: parvenir à un accord. C’est précisément l’objectif de la campagne «Peace from Below» (La paix par le bas) [12], lancée en novembre 2024 par des émigrés de gauche russes et ukrainiens lors du Forum de Cologne (novembre 2024).
- La première étape consiste à mobiliser et à organiser les partisans, en commençant par ceux qui sont en exil. Aujourd’hui, il y a plusieurs millions de réfugiés russes et ukrainiens rien qu’en Europe, mais seuls quelques centaines d’entre eux sont membres d’organisations ou de groupes politiques. Cela s’explique notamment par le caractère antidémocratique de la plupart des programmes de ces organisations et leur contradiction de plus en plus flagrante avec le désir de paix de la majorité. Notre tâche n’est pas de nous battre dans le monde étroit des militants politiques professionnels, mais de trouver des moyens d’organiser des milliers de personnes démobilisées.
- Cela permettra de remplir la mission centrale de l’émigration politique: devenir la voix de millions de compatriotes qui, sous la répression et la censure, ne peuvent pas dire haut et fort ce qu’ils pensent vraiment.
- Le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine n’est pas isolé du contexte mondial. La violence militaire se propage rapidement à travers le monde: Gaza, Liban, Iran, Syrie. L’Europe est submergée par une vague de militarisation. Aux Etats-Unis, l’administration Trump cherche ouvertement à instaurer un régime autoritaire et menace même d’intervenir militairement contre des alliés traditionnels tels que le Canada, le Mexique, le Panama et le Danemark. La place des militants de gauche russes n’est pas dans les derniers rangs des salles où se réunit le parti occidental de la guerre, mais parmi les participants au mouvement anti-guerre. Nous devons rejoindre nos camarades dans la lutte commune contre l’extrême droite, les bellicistes et le capital oligarchique qui entraînent tous les pays vers une dictature ouverte et une guerre sans fin. C’est seulement ainsi que nous pourrons être vraiment utiles à notre pays.
(Publié dans Rabkor le 27 juillet 2025. Traduit pour Links du russe en anglais par Dmitry Pozhideav et publié le 15 août 2025 sur le site links.org; traduction rédaction A l’Encontre)
Alexey Sakhnin est un journaliste, militant et homme politique russe de gauche, anciennement associé au mouvement Front de gauche. Il a été l’un des leaders du mouvement de protestation anti-Poutine de 2011 à 2013 et est membre du Progressive International Council (Conseil progressiste international). Il a beaucoup écrit sur la politique russe, les mouvements sociaux et les affaires internationales, souvent dans une perspective marxiste. Depuis qu’il s’est exilé en raison de persécutions politiques, il a contribué à divers médias indépendants, tels que Jacobin.
Liza Smirnova est une journaliste et militante russe de gauche, connue pour ses reportages et ses commentaires sur les questions de justice sociale, les droits du travail et les mouvements anti-guerre. Elle est également active en exil, participant à des réseaux de solidarité internationale et contribuant à des publications indépendantes.
____________
- «Opération militaire spéciale» est le terme officiel utilisé par les autorités russes pour décrire l’invasion de l’Ukraine. En vertu de la loi russe, le fait de la qualifier de guerre peut faire l’objet de poursuites pénales.
- Alexei Navalny (1976-2024) était un leader de l’opposition russe, avocat et militant anti-corruption. Il s’est fait connaître pour ses enquêtes sur la corruption des fonctionnaires russes et son opposition au régime de Vladimir Poutine. Navalny a été emprisonné en 2021 et est décédé en détention en février 2024 dans des circonstances largement considérées par ses partisans et les observateurs internationaux comme étant motivées par des raisons politiques.
- Vladimir Milov est un homme politique russe de l’opposition, économiste et ancien vice-ministre de l’Energie de la Fédération de Russie. Proche collaborateur d’Alexei Navalny, il a participé à l’élaboration du programme économique «Nouvelle Russie» (NB) de Navalny, qui proposait des réformes libérales visant à restructurer l’économie russe. Milov vit en exil depuis 2010 et critique ouvertement le gouvernement de Vladimir Poutine. En 2021, le ministère russe de la Justice l’a désigné «agent étranger».
- Ilya Yashin (né en 1983) est un homme politique russe de l’opposition, ancien conseiller municipal à Moscou et critique de longue date du régime de Vladimir Poutine. Connu pour son activisme et ses discours publics contre la corruption et l’autoritarisme, Yashin a été désigné «agent étranger» et condamné en décembre 2022 à huit ans et demi de prison pour «diffusion de fausses informations» sur l’armée russe, après avoir condamné la guerre en Ukraine. Le 1er août 2024, il a été libéré dans le cadre du plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide (réalisé à Ankara, en Turquie), où il a été échangé contre des agents et des collaborateurs russes détenus en Occident.
- FBK – La Fondation anti-corruption (Fond Borby s Korruptsiei) a été fondée par Alexei Navalny en 2011 en tant qu’organisation à but non lucratif chargée d’enquêter et de dénoncer la corruption parmi les hauts fonctionnaires russes. Les autorités russes ont désigné la FBK comme «agent étranger» en 2019 et comme «organisation extrémiste» en 2021, interdisant de fait ses activités en Russie. Bon nombre de ses dirigeants opèrent désormais depuis l’exil.
- Yulia Navalnaya est la veuve d’Alexei Navalny et une figure publique de l’opposition russe. Après l’emprisonnement puis la mort de son mari en 2024, elle est devenue l’une des leaders les plus en vue du mouvement anti-Poutine en exil, plaidant en faveur de sanctions internationales contre les dirigeants russes et cherchant à obtenir le soutien politique de l’Occident pour l’opposition. En 2025, les autorités russes l’ont qualifiée à la fois de «terroriste» et d’«extrémiste».
- Tamara Eidelman est une historienne, éducatrice et intellectuelle publique russe, connue pour ses conférences d’histoire très populaires et sa chaîne YouTube. Critique virulente du gouvernement de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine, elle a quitté la Russie en 2022 et est depuis active en exil, participant à des forums d’opposition et à des débats publics. En 2022, le ministère russe de la Justice l’a désignée «agent étranger».
- Le Forum Yulia Navalnaya, également appelé «Plateforme pour une Russie future», réunit des experts russes et des figures de l’opposition en exil afin de discuter de plans de réforme et de transition démocratique. Le forum inaugural s’est tenu du 8 au 10 novembre 2024, et le deuxième a eu lieu du 9 au 11 mai 2025.
- Mikhail Lobanov (né en 1984) est un mathématicien, syndicaliste et homme politique russe de gauche. Ancien maître de conférences à l’université d’Etat de Moscou, il s’est fait connaître pour son opposition aux réformes de l’éducation et sa défense des droits du travail. En 2021, il s’est présenté comme candidat indépendant de gauche avec le soutien du PCFR à la Douma d’Etat, mais a été empêché de remporter les élections par le recours à la manipulation du «vote intelligent» et à des fraudes électorales présumées. Lobanov a quitté la Russie en 2022 après avoir été victime de persécutions politiques. En 2023, le ministère russe de la Justice l’a désigné «agent étranger».
- Lev Shlosberg est un homme politique libéral, journaliste et militant des droits humains russe originaire de la région de Pskov. Membre du parti Iabloko, il est connu pour ses enquêtes sur la corruption locale, son plaidoyer en faveur de réformes démocratiques et son opposition aux interventions militaires russes, notamment en Ukraine. Shlosberg a été victime de persécutions politiques répétées, notamment d’agressions physiques, d’inéligibilité et de poursuites pénales. En 2023, le ministère russe de la Justice l’a désigné «agent étranger».
- «Parti du sang des autres» – Il s’agit d’une expression péjorative utilisée dans la rhétorique politique russe pour accuser les opposants de soutenir la guerre ou l’intervention militaire étrangère au prix de vies russes.
- Peace from Below (Mir snizu) est une initiative populaire lancée en novembre 2024 par des militants de gauche russes et ukrainiens en exil. Elle vise à favoriser le dialogue et la coopération entre les citoyens ordinaires des deux côtés du conflit, en plaidant pour la fin immédiate des hostilités et une paix négociée, contrairement aux programmes politiques officiels axés sur la victoire militaire.
