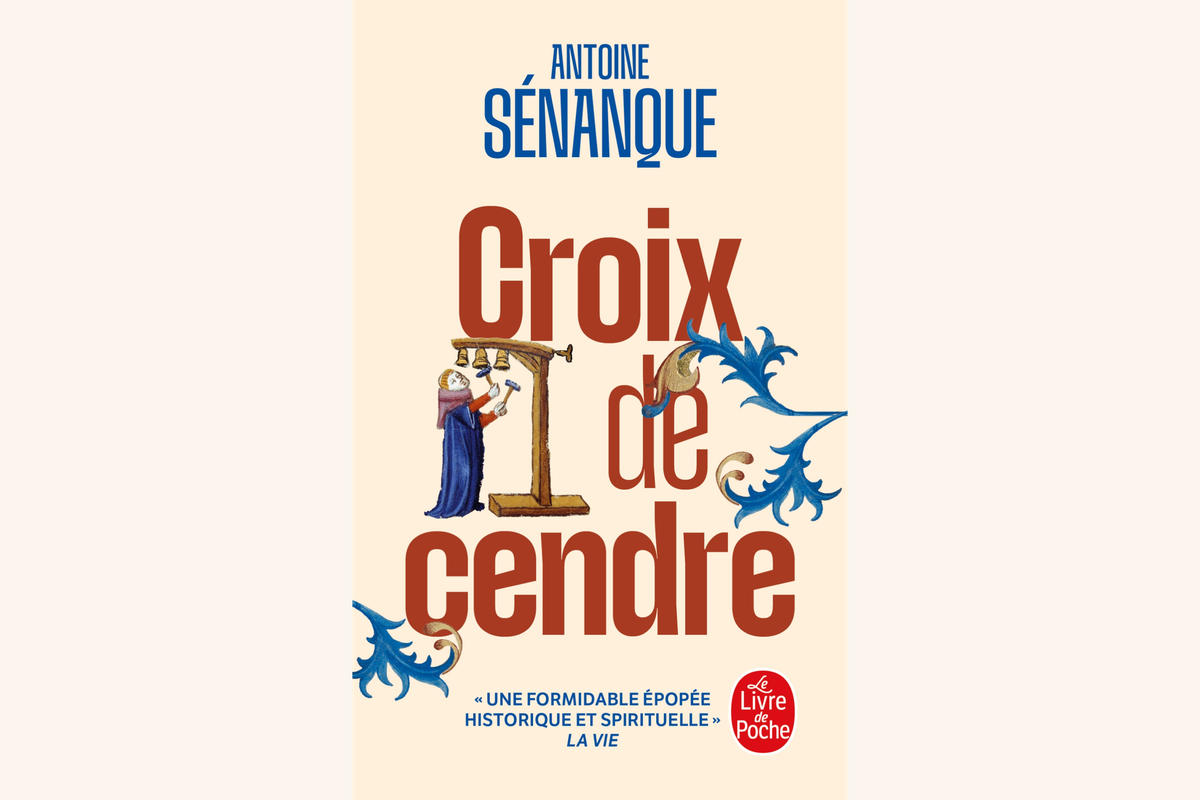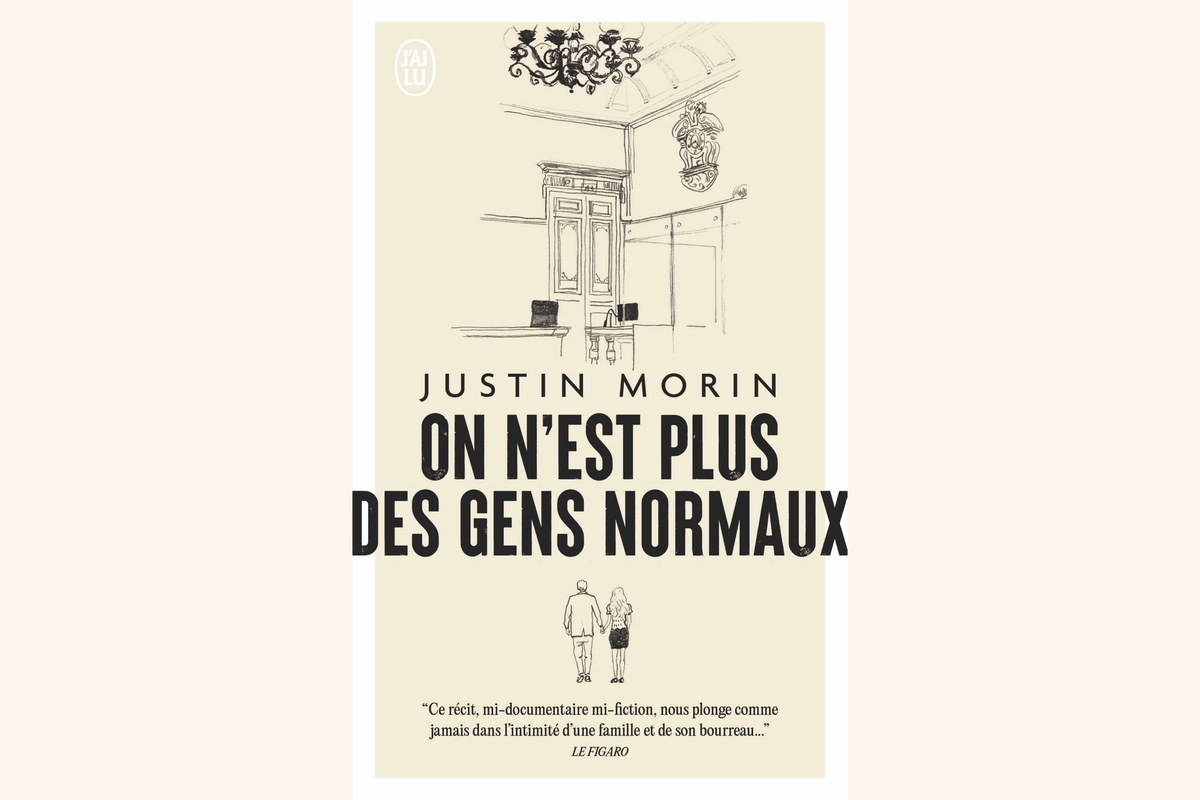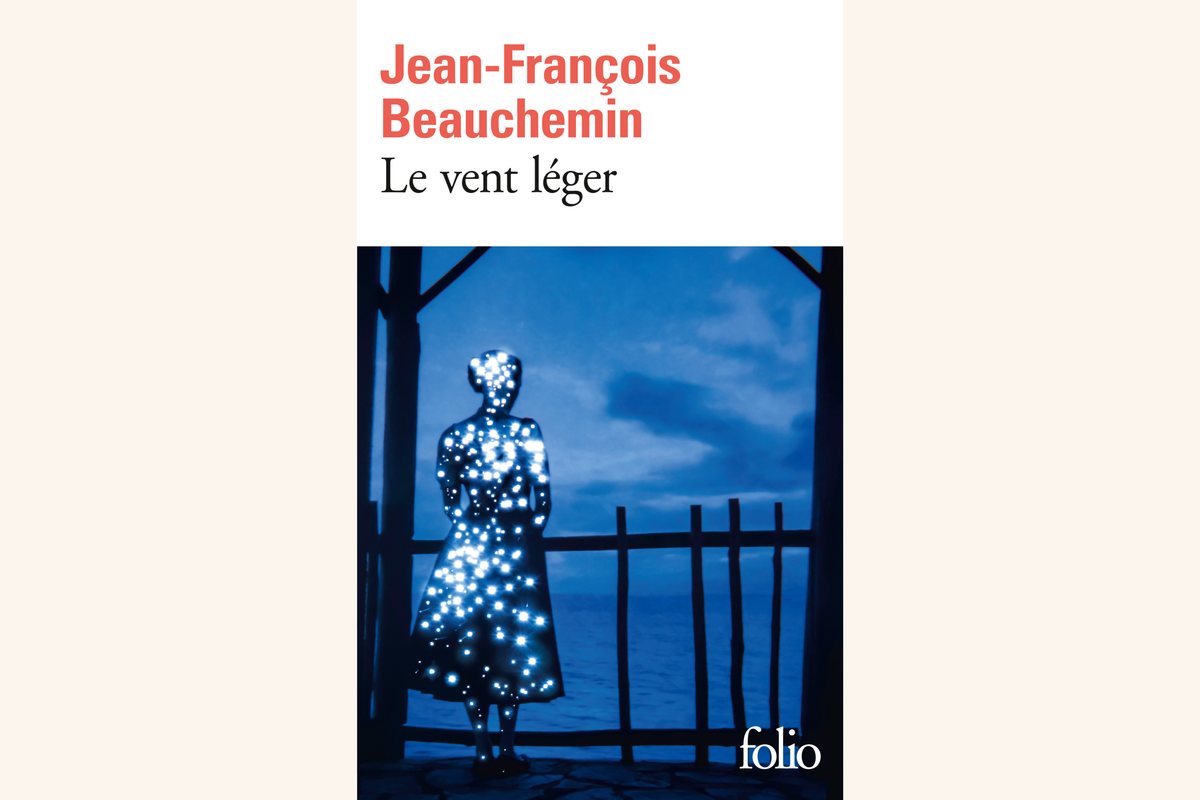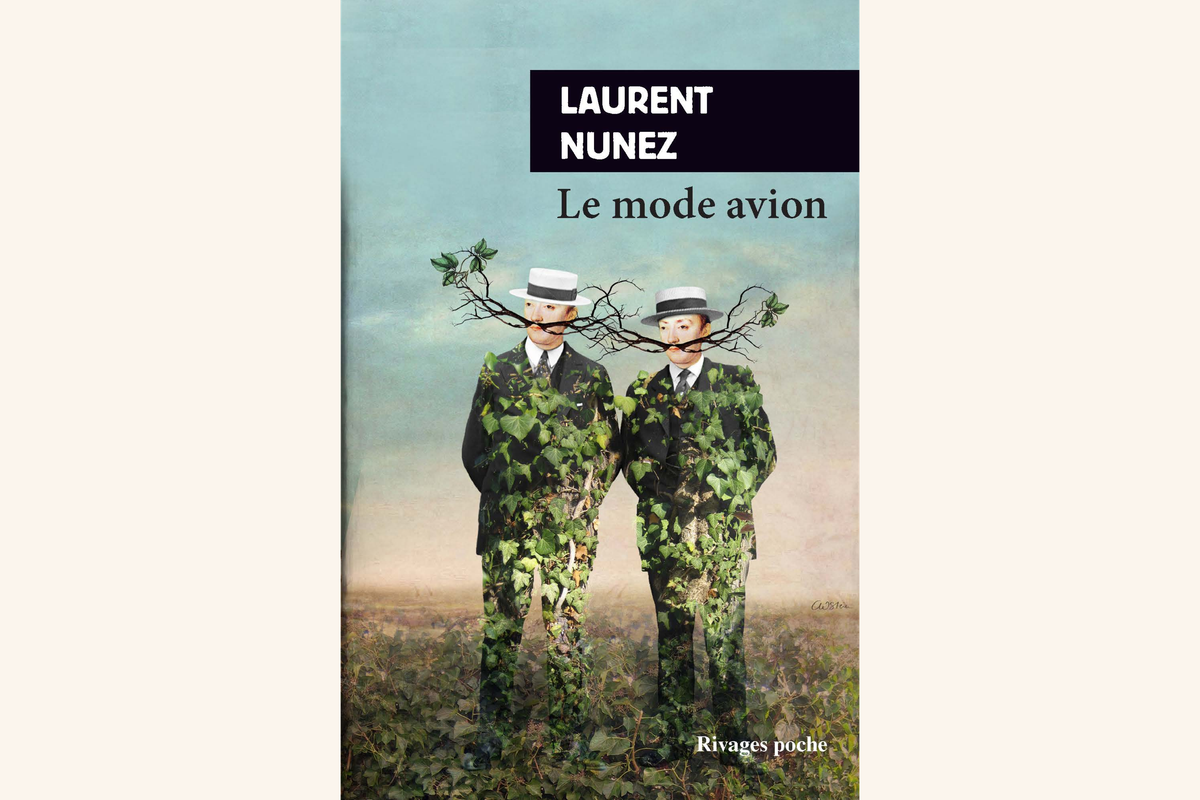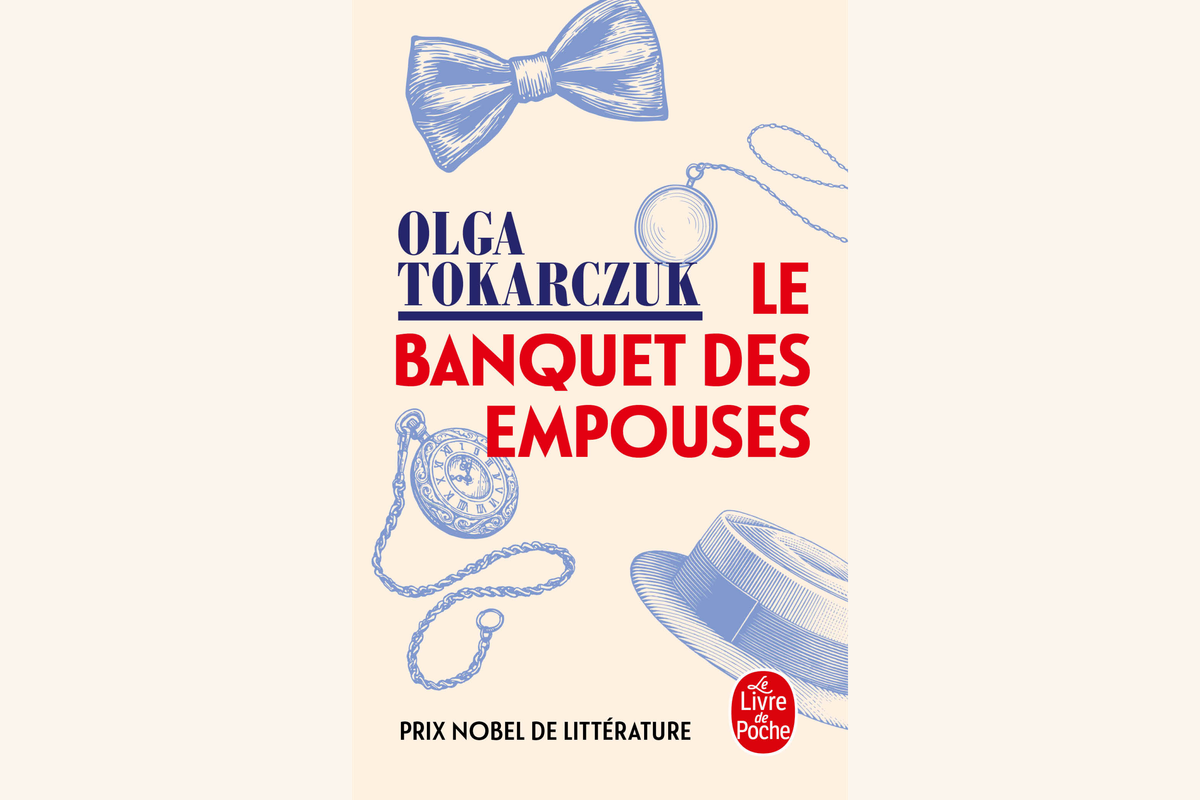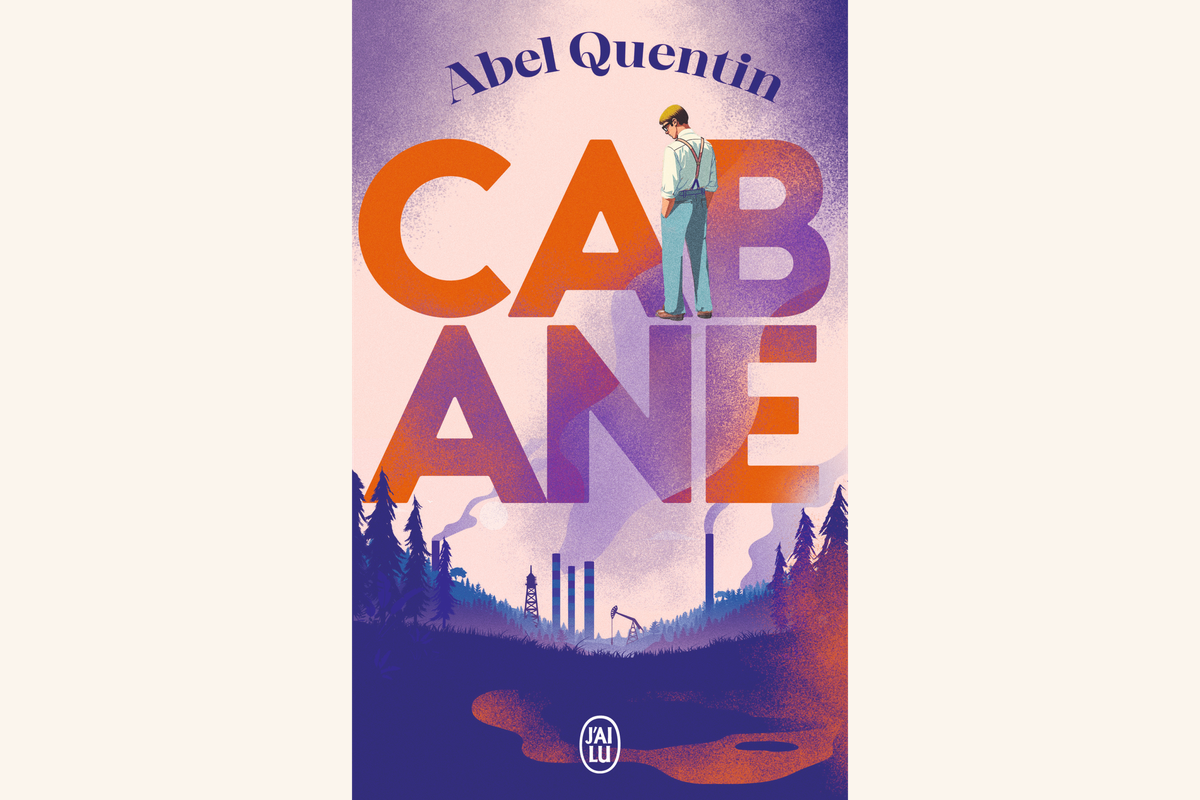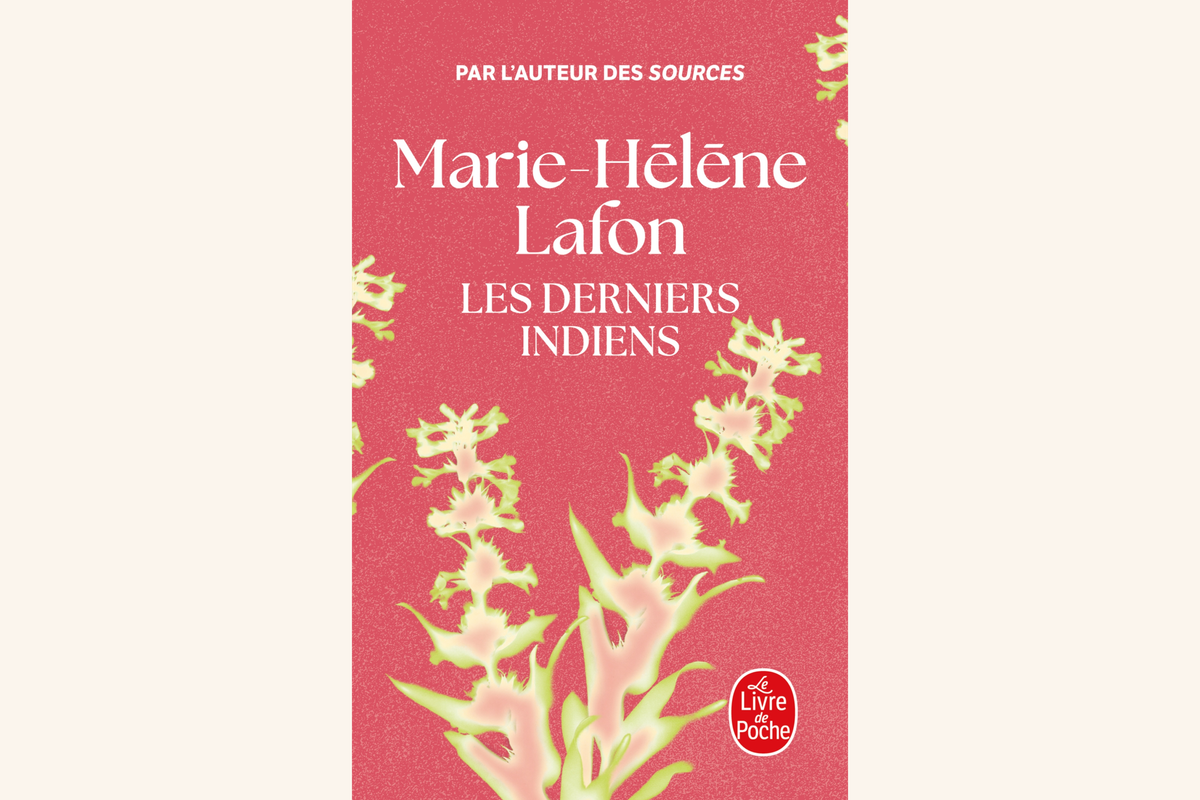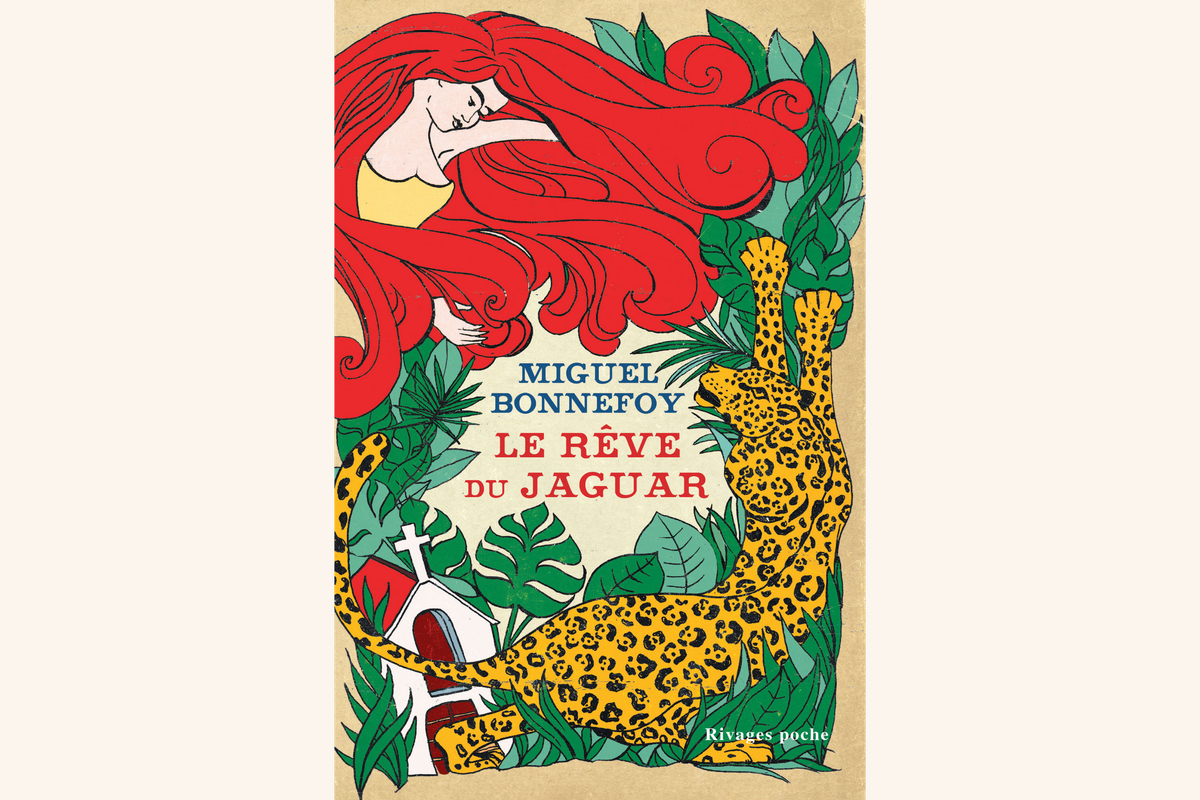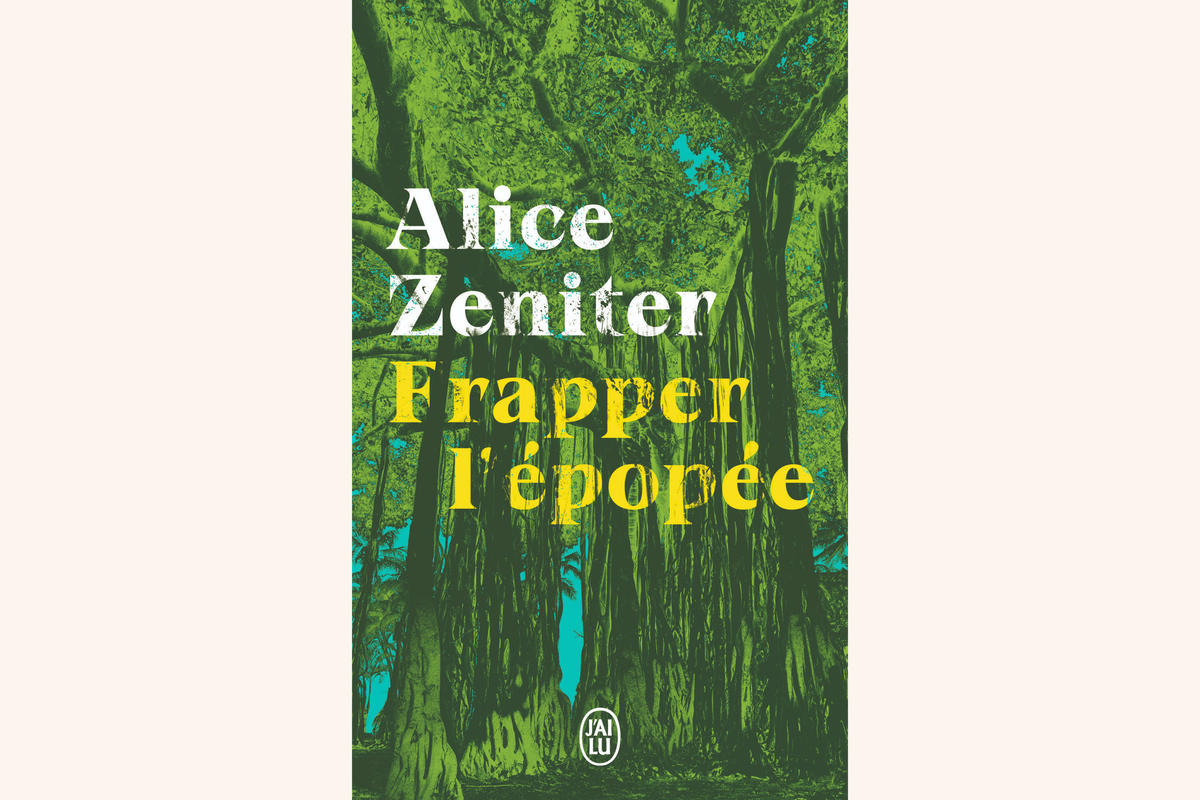Entre éclats d’intime, fictions du réel, voix nouvelles et récits habités, chacun creuse à sa manière une ligne sensible dans le paysage de la rentrée. Un bouquet de lectures légères ou profondes, toujours singulières, pour finir l’été avec justesse. 
Natasha Brown autrice de « Assemblage ». Photo Alice Zoo
Publié le 29 août 2025 à 10h00
Partager
Favoris
Lire dans l’application
“Assemblage”, de Natasha Brown
Elle n’a pas ménagé ses efforts, elle a mis toute son énergie, et même davantage, à « ce dépassement sans fin » d’elle-même. « Je suis tout ce qu’on m’a dit de devenir. Ça ne suffit pas », constate pourtant la narratrice d’Assemblage. Jeune Britannique noire, issue d’une famille modeste, elle a excellé à l’école et à l’université et gravite désormais dans l’univers glacé et suffisant de la finance. Son petit ami blanc est un héritier, rejeton d’une famille de la haute bourgeoisie anglaise. Comme une créature au corps élastique, elle s’est coulée dans les codes culturels et les mœurs d’un monde au seuil duquel elle demeure. À travers le monologue de sa narratrice, Assemblage ne fait entendre nulle plainte. Une colère plutôt, froide et nette, même si elle est mêlée de lassitude, d’angoisse sourde, de crâne renoncement. Une tonalité inconfortable, rugueuse, dérangeante, qui tout ensemble porte et irrigue une narration morcelée au fil de laquelle la jeune femme déroule les faits – les gestes, les symboles, et surtout les mots, révélateurs, à l’insu de ceux qui les prononcent, des hiérarchies avérées et non dites, du rejet racial et social, du mépris de genre – et les dissèque avec une intelligence critique implacable. Ne s’épargnant pas elle-même tandis qu’elle examine, l’âme intranquille, son acquiescement à ce système qu’elle est sur le point de résilier. « Née ici, de parents nés ici, jamais vécu ailleurs – pourtant jamais d’ici », résume-t-elle sans pathos, au fil de ce (premier) roman d’une éclatante maîtrise, à teneur hautement politique, mais non moins incarné et remuant. — Na.C.
Éd. Le livre de poche, 7,90 €.
Lire notre critique
« Assemblage », de Natasha Brown
“Croix de cendre”, d’Antoine Sénanque
Un prieur, un sacristain, deux moines, un inquisiteur et des oblats… Nous sommes au XIVᵉ siècle, ravagé par l’épidémie de peste de 1348. Mais si ce roman d’Antoine Sénanque est une histoire religieuse, s’il fait la part belle aux dimensions symboliques, aux doutes qui sans cesse tenaillent les âmes des protagonistes, il est aussi un formidable roman d’aventures où les corps et le spirituel se conjuguent et où les enjeux politiques prennent parfois le dessus sur toute autre considération. Merveilleusement écrit, le roman d’Antoine Sénanque prend peu à peu les rythmes d’un polar médiéval dont le suspense se savoure des laudes jusqu’aux vêpres. — G.H.
Éd. Le livre de poche, 9,70 €.
Lire notre critique
“Croix de cendre”, d’Antoine Sénanque
“On est plus des gens normaux”, de Justin Morin
À l’été 2017, un automobiliste a foncé sur la terrasse d’une pizzeria de Seine-et-Marne, tuant Angela, 13 ans, et faisant des dizaines de blessés. Quelques années plus tard, Justin Morin couvre le procès comme journaliste. Lui qui, pour son travail, voit défiler les faits divers, est touché différemment, peut-être parce qu’il vient de devenir père. Il est marqué par la solidarité entre les victimes, mais aussi par la solitude de la sœur du criminel, appelée à la barre. Le projet d’écriture naîtra de la volonté de raconter, d’abord, le difficile statut de victime. Ce récit est poignant car le journaliste se fait subtilement écrivain et trouve le ton juste, entre le recueil soigné de la parole et l’étude ciselée d’émotions complexes. Mais l’autre déclencheur d’On n’est plus des gens normaux vient de l’interrogation face à la loyauté de la sœur envers son frère coupable. C’est un chemin de crête, sur lequel le primo-romancier évolue avec sensibilité, sans doute aidé par son passage dans un master de création littéraire. Sous sa plume, la fiction assumée apparaît comme le moyen le plus honnête de traiter ce qui n’a pu être transmis. — Y.L.-S.
Éd. Folio, 8,00 €.
Lire notre critique
“On n’est plus des gens normaux”, de Justin Morin
“Le vent léger”, de Jean-François Beauchemin
Un chevreuil au fond du jardin, le chant des oiseaux, tout l’émerveille. Peu connu en France, le Québécois Jean-François Beauchemin nous enchante avec ses livres. Personne ne déplorera l’accélération réparatrice qui se fait sentir aujourd’hui, alors que sont proposés au public français « Le vent léger » au titre aussi délicat que leur contenu, qui sonde le chagrin, mêlé d’irréductible allégresse, de six enfants bientôt endeuillés par la perte de leur mère. — M.L.
Éd. Folio, 8,00 €.
À lire aussi :
Jean-François Beauchemin : « J’écris pour une seule raison : célébrer la joie d’être vivant »
“Le Mode avion”, de Laurent Nunez
Étienne Choulier, « homme de science » ? Considérant sa statue à Fontan, petit village des Alpes-Maritimes, le narrateur, dubitatif, mène l’enquête. Le fameux Choulier était, dans les années 1930, un homme discret, que ses collègues jugeaient « saugrenu », et aussi, accessoirement, le plus jeune agrégé de grammaire de France. Il désarçonnait ses interlocuteurs en déclarant : « C’est incurable hélas. J’ai une très grave maladie, horrible de nos jours : je vois le langage… » À la cantine de la Sorbonne, il fit la connaissance de Stefán Meinhof, autre universitaire, qui lui dit : « Idem pour moi. » Voir le langage devint alors leur obsession commune. Emménageant dans un vieux mas à Fontan, les deux hommes s’immergent dans l’étude, pour « déterrer un trésor philologique », une théorie inédite. Dans son carnet, Choulier note ses interrogations : « Pourquoi « tout attaché » s’écrit-il séparément, alors que « séparément » s’écrit tout attaché ? » Il croit avoir enfin construit son théorème quand Meinhof est sûr, lui aussi, de tenir sa théorie. Les années passent… Qu’adviendra-t-il des deux compères ? Le Mode avion, petit livre d’aventure intellectuelle, facétieux, savoureusement drôle et érudit, est un beau clin d’œil à Bouvard et Pécuchet, les deux « cloportes » de Gustave Flaubert. — G.H.
Éd. Rivages-Poche, 8,70 €.
Lire notre critique
« Le Mode avion », de Laurent Nunez
“Le Banquet des Empouses”, d’Olga Tokarczuk
Pour qui accepte l’invitation (foncez !), Olga Tokarczuk vous embarquera dans un livre-monde de sous-bois humides et de sommets mélancoliques, de sinistres secrets et de liqueurs de champignons hallucinogènes, de douches glacées et de symphonies de toux, de meurtres rituels et de créatures étranges aux visages de mousse. — W.Z.
Éd. Le livre de poche, 9,40 €.
Lire la critique
“Le Banquet des Empouses” d’Olga Tokarczuk : les sorcières s’invitent au bal des misogynes
“Cabane”, d’Abel Quentin
Avocat pénaliste quand il n’écrit pas, Abel Quentin, 38 ans, n’est guère politiquement correct. Voilà pourtant qu’il s’attaque vertueusement, dans Cabane, son troisième et copieux roman, aux dérives mortifères de notre culture de la croissance. Plus sombre et tragique que d’ordinaire, Abel Quentin suit jusqu’à aujourd’hui le destin des très écolos Dundee devenus éleveurs de porcs, du cynique Quérillot reconverti dans l’industrie pétrolière, de l’idéaliste Gudsonn devenu apôtre de la décroissance. Une fresque brillante qui caracole dans les milieux, les lieux, les plus divers. Surgi au milieu du récit et vite fasciné par Gudsonn, le narrateur, journaliste un rien paumé du très discret mensuel Zones, est le seul personnage farce de cette randonnée au royaume des illusions perdues de la modernité. — F.P.
Éd. J’ai lu, 9,50 €.
Lire notre critique
“Cabane”, fresque sarcastique et climatique d’Abel Quentin
“Les Derniers Indiens”, de Marie-Hélène Lafon
Dans ses nouvelles (Liturgie, Organes) comme dans ses précédents romans (Le Soir du chien, Sur la photo), toujours elle élimine le superflu, décrit l’âpreté du quotidien, les jours décolorés, la terre qui colle aux chaussures et finit par épaissir les âmes comme les semelles. Avec des phrases courtes, avares d’adjectifs, elle dit la solitude, les silences, mais aussi les rituels : les naissances et les enterrements, le linge plié et déplié, la sexualité interdite. Les Derniers Indiens est une histoire d’attente et de mort, un livre sur l’orgueil qui vous empêche de traverser la route et vous laisse un jour, seul derrière la vitre de la cuisine, à surveiller ceux d’en face pour tenter de comprendre la recette du bonheur.
Éd. Le livre de poche, 7,90 €.
Lire notre critique
“Le Rêve du jaguar”, de Miguel Bonnefoy
D’emblée, le narrateur prévient : ce bébé abandonné sur un trottoir est voué à un destin exceptionnel. D’ailleurs, cette rue finira par porter son nom. Puis il déploie un décor foisonnant où se mêlent l’histoire mouvementée du Venezuela et l’odyssée d’Antonio. Ces péripéties sont-elles réelles ou leur transmission au fil du temps les a-t-elle transformées en légende ? L’épopée court sur quatre générations et s’étire comme le long chant d’une fable qui fredonne, module, vocalise au rythme de l’histoire familiale. Gorgé de couleurs et d’images, le récit rebondit, cavale à la poursuite de l’aventure, régulièrement rattrapé par les soubresauts d’un pays où les révolutions se produisent avec la régularité d’un métronome. — E.D.
Éd. Rivages-Poche, 9,50 €.
Lire notre critique
“Frapper l’épopée”, d’Alice Zeniter
Après avoir étudié puis travaillé en métropole plusieurs années, Tass est de retour à Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, où elle est née et a grandi, et où l’attend un poste de prof de français. Parallèlement au récit du retour de Tass, Alice Zeniter installe, au cœur de l’intrigue de Frapper l’épopée, un autre pôle de l’action : un mystérieux groupuscule d’activistes indépendantistes kanaks dont les actions subversives s’inscrivent dans une énigmatique démarche politique qu’ils qualifient d’« empathie violente ». L’ambitieuse et talentueuse autrice tirera bientôt d’autres fils, tandis que son brillant roman s’ouvre vers le passé. Se penchant sur le rôle de colonie pénitentiaire qu’assigna à la Nouvelle-Calédonie, au milieu du XIXᵉ siècle, le nouveau pouvoir colonial français. Et, parmi les déportés, zoomant sur les Algériens qui furent amenés sur le Caillou et durent apprendre à y vivre – parmi eux, Areski, l’aïeul de Tass. Construction romanesque virtuose, Frapper l’épopée est tout ensemble un grand roman politique et sensible, poétique et incarné. — Na.C.
Éd. J’ai lu, 9,20 €.
Lire notre critique
“Frapper l’épopée”, d’Alice Zeniter