Ces dernières années, de nombreux écrivains se sont penchés sur le monde de la justice. Après Notre solitude, de Yannick Haenel, Emmanuel Carrère a publié V13. Avec Balle perdue, s’il est encore question d’une forme profonde de solitude, ce n’est pas au procès d’un attentat que s’intéresse Nane Beauregard, encore moins à un procès récent et médiatique, mais plutôt à la personnalité de Pascual Lozano, un jeune homme d’origine hispanique condamné à mort pour avoir tué une fillette d’une balle perdue au tournant des années 2000.
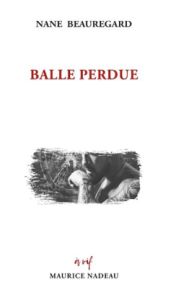
C’est bien lui, Pascual — qu’elle rapproche de l’agneau mystique peint par Van Eyck —, que l’écrivaine s’attache à comprendre, en décryptant ses moindres faits et gestes, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’elle se préoccupe de Genesis, la jeune fille tuée à l’âge de neuf ans. Elle le dit d’ailleurs d’emblée et sans ambages : « Je ne vois que lui, je n’ai d’yeux que pour lui », allant jusqu’à écrire : « Il se met, comme dans l’amour, à occuper toutes mes pensées, toute ma vie même, et je sais déjà que je n’en ai pas fini avec lui, que cela va me prendre des années ».
En examinant de très près le déroulé du procès, Nane Beauregard rappelle que le mutisme est une prison qui vaut toutes les accusations, faisant de l’accusé un bouc émissaire et une sorte de cousin éloigné de Meursault ou de Joseph K. qui, sortant enfin de son silence, pourrait s’écrier comme à la fin de L’Étranger : « Et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine ». Car pour Pascual Lozano, « être innocent et le savoir est suffisant ».
On devine que ce procès aujourd’hui méconnu l’a longtemps possédée elle-même, puisqu’il a eu lieu il y a près d’un quart de siècle. Au fil des pages, se développe une véritable recherche de la balle perdue, tant l’écrivaine ne narre pas chronologiquement les faits, mais s’attache plutôt à montrer ce qui se cache derrière les phrases toutes faites, les mots galvaudés à force d’être remâchés, y compris dans les tribunaux. Elle expose ainsi à quel point la justice, et même la société, peuvent être grotesques, comment un seul mot — en l’occurrence, uriner — dérange plus que l’objet même du procès — la mort d’une jeune fille innocente : « On ne va tout de même pas dire ‘pisser’, comme tout un chacun, comme n’importe qui dirait, on va parler de ‘salle de bains’ pour désigner un coin de trottoir miteux ».
Au fil des pages, la justice apparaît de façon parodique, qu’il s’agisse des trois avocats commis d’office ou de la défense pour qui il est vulgairement question de lose lose alors que l’accusé, déjà condamné à mort, risque toujours sa vie dans un second procès. Devant la faiblesse des preuves retenues à l’encontre de ce dernier, Nane Beauregard fait un portrait cinglant d’une des avocates de la partie adverse : « Mais Miss Monroe qui joue au tennis et au golf de la main droite alors qu’elle est gauchère ne l’entendra pas de cette oreille ». Or, d’oreille, il est rarement question lors du procès, comme elle le souligne : « Parfois, peut-être, seul le silence peut répondre. Parfois, peut-être, manque-t-il les questions elles-mêmes ».

Les digressions de Balle perdue donnent accès à la complexité du procès aussi bien qu’à la bêtise du fonctionnement judiciaire et au chantage obscène qui consiste à écouter certains témoins qui viennent moins à la barre pour livrer leur version des faits que pour ne pas être expulsés du pays. Il n’y a pas un protagoniste qui échappe à son regard acéré, lequel a le mérite de constamment remettre en cause le mode de décision judiciaire : « A-t-il pensé à tout ça, ce juré dans son short et ses certitudes de nanti, dont on nous montre le petit ventre bien replet et l’air satisfait de celui qui est sûr de son bon droit ». Avec ce texte, elle donne à voir sans concession et d’une manière redoutable l’insoutenable légèreté de la justice.
D’une grande puissance poétique, Balle perdue s’attarde également sur la notion d’honneur que le silence de l’accusé recouvre. Nane Beauregard ausculte aussi certains clichés de la jeune fille : « On sent qu’elle n’a pas de temps à perdre pour la coquetterie et, l’avenir le dira, elle n’a pas de temps du tout ». Mais le plus émouvant, sans doute, reste le croisement qu’elle opère entre la famille de la victime et celle de l’accusé. Les deux mères sont des sortes de sœurs qui s’ignorent tout en se reconnaissant dans le fait de la perte d’enfants qui étaient pourtant innocents et dont la situation pourrait tenir dans le parallélisme suivant : « L’une a déjà tout perdu et l’autre risque de la rejoindre ».
Le fait est que lecteur finit par s’attacher lui aussi à un suspect qui, à la manière de Montaigne, se demande : « Comment savoir ? ». Son silence, que l’on prend pour de la culpabilité, apparaît plutôt comme une forme de sagesse. L’écrivaine, en plus d’écrire sur l’indicible, questionne les moments insolites où la parole nous fait chanceler : « C’est ce moment rare, exceptionnel, auquel nous assistons, où un événement, n’importe lequel, et parfois, une phrase, même banale, même anodine, ou simplement un mot, un mot qui se mettra à résonner, ce jour-là, différemment de toutes les autres fois, sauront jouer ce rôle de nous réveiller et de nous sortir du sommeil, de l’engourdissement et de la torpeur, dans laquelle nous préférons tous dormir nos vies ».
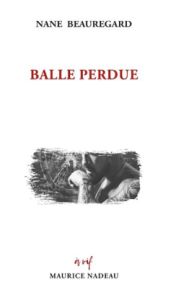
Par moments, Balle perdue tend vers la tragédie antique, notamment lorsque Tania, la sœur de Genesis, s’exprime ainsi lors du procès : « Si, au moins, elle avait pu me répondre ». De même, l’existence d’un « accusé parfait », fût-il innocent, n’est pas sans rappeler un engrenage tragique. Une certitude demeure à la fin : contre l’injustice, il n’y a ni pourquoi ni réponse — raison pour laquelle, à rebours de la société actuelle saturée par la parole jusque dans les cours d’assises, il s’agit d’apprendre à écouter.
Nane Beauregard, Balle perdue, éditions Maurice Nadeau/Lettres nouvelles, mars 2024, 162 pages, 19€.
Articles similaires
