Prévenir la transmission d’une maladie grave plutôt que tenter de la soigner une fois installée, telle est la promesse croissante de certaines avancées en médecine reproductive. Alors que les techniques de fécondation in vitro ont déjà bouleversé les parcours de nombreuses familles, une nouvelle approche repousse encore les limites du possible. En ciblant l’ADN des mitochondries, la FIV à trois ADN ambitionne de réduire fortement le risque de transmission de certaines affections incurables.
chaque grossesse devient un risque redouté.
C’est dans ce contexte que des chercheurs de l’université de Newcastle ont mis au point une technique permettant de contourner ce risque. Ils transfèrent le noyau de l’ovocyte de la mère dans un ovocyte de donneuse, préalablement énucléé mais porteur de mitochondries saines. Ils fécondent ensuite in vitro (FIV) cet ovocyte ainsi reconstruit avec les spermatozoïdes du père, ce qui donne naissance à un embryon portant l’ADN nucléaire des deux parents et l’ADN mitochondrial d’une tierce donneuse.
Cette approche vise à éliminer, autant que possible, la transmission des maladies mitochondriales. Selon les données publiées dans The New England Journal of Medicine, cinq des huit enfants nés ainsi ne présentaient aucune trace détectable de mutations pathogènes, tandis que les trois autres affichaient des niveaux faibles, jugés non préoccupants. Cette avancée représente un tournant pour les femmes dont tous les ovocytes sont porteurs de mutations, y compris après sélection embryonnaire classique.
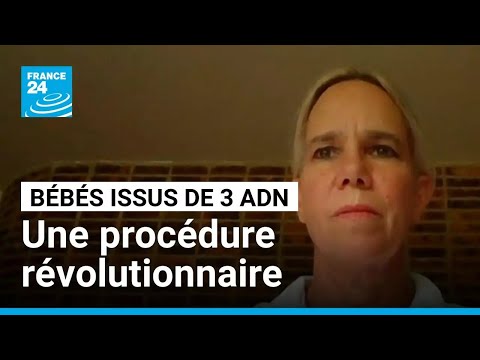
La FIV à trois ADN comme réponse aux limites des traitements classiques
Jusqu’ici, les options pour les familles porteuses de maladies mitochondriales se limitaient à l’adoption, au recours à un ovocyte entièrement donneur, ou à la sélection embryonnaire lorsque les mutations étaient peu nombreuses. Mais pour celles dont les ovocytes sont tous atteints, la médecine reproductive n’offrait aucun moyen de concevoir un enfant biologiquement lié aux deux parents sans risquer une transmission.
C’est précisément à cette impasse que répond la FIV à trois ADN. Le Royaume-Uni l’a autorisée par la loi en 2015, en posant des conditions strictes et en la limitant à la prévention de maladies graves. L’Australie a ensuite emprunté la même voie. Aux États-Unis, en revanche, le Congrès maintient l’interdiction de toute recherche impliquant des modifications génétiques transmissibles. Plusieurs chercheurs, notamment au Francis Crick Institute, ont pourtant rappelé à de nombreuses reprises cette distinction fondamentale entre l’édition du génome et le remplacement mitochondrial, en soulignant que la donneuse ne transmet aucun trait visible ni comportemental à l’enfant, comme le souligne Science.
La technique utilisée par l’équipe britannique s’appelle le transfert pronucléaire. Elle consiste à intervenir juste après la fécondation, en extrayant les deux noyaux de l’embryon des parents pour les insérer dans un embryon donneur, déjà fécondé mais vidé de son propre matériel génétique. Cette manipulation exige une maîtrise extrême des délais et des gestes, mais elle permet de conserver l’identité génétique des parents tout en éliminant les mitochondries défectueuses.
Pourquoi le suivi de ces enfants sera déterminant pour l’avenir de la méthode
Malgré l’enthousiasme suscité par les premiers résultats, les scientifiques restent prudents. Car si la méthode semble efficace à court terme, rien ne garantit encore l’absence d’effets indésirables sur le long cours. Les enfants nés grâce à cette technique seront suivis médicalement jusqu’à l’âge de cinq ans, avec une attention particulière portée à leur développement neurologique, leur croissance et leur santé globale.
L’une des incertitudes majeures concerne la possible présence de mitochondries défectueuses dans l’embryon. Même lorsque seul le noyau est transféré, une très faible quantité de cytoplasme peut l’accompagner. Par conséquent, quelques mitochondries maternelles peuvent aussi passer. Dans certains cas, jusqu’à 16% de l’ADN mitochondrial détecté provenait encore de la mère. Certes, ce taux reste bien en dessous du seuil pathologique, estimé à 80%. Toutefois, il souligne l’importance d’un encadrement rigoureux et d’un suivi continu.
Par ailleurs, certains bioéthiciens rappellent que cette avancée, si elle venait à être étendue à d’autres contextes médicaux ou sociaux, pourrait raviver le spectre des dérives eugénistes. Modifier l’embryon, même de manière indirecte, reste un sujet sensible. Selon AP News, plusieurs chercheurs, dont Stuart Newman et François Baylis, mettent en garde contre un risque culturel croissant. En effet, la généralisation des interventions génétiques pourrait banaliser des pratiques longtemps considérées comme sensibles. Pourtant, dans ce cas précis, l’objectif n’est pas de concevoir un enfant parfait. Il s’agit simplement d’éviter la transmission d’une maladie incurable.
Pour les parents concernés, les questions éthiques passent au second plan face au soulagement ressenti. À ce jour, huit familles élèvent un enfant en bonne santé, alors que tout espoir semblait perdu. Ce résultat, bien que partiel, suffit néanmoins à encourager la poursuite des recherches. La science progresse. Toutefois, elle devra s’appuyer sur un suivi attentif de ces enfants, et peut-être un jour, de leurs propres descendants.
