Lorsqu’une personne perd connaissance, les témoins
se précipitent généralement pour lui
venir en aide. Toutefois, il semblerait que nous ne soyons pas
les seuls à agir ainsi. Une étude révolutionnaire vient en effet de
révéler que les souris tentent elles aussi de ranimer leurs
congénères inconscients en employant une technique de réanimation
inattendue qui rappelle étonnamment nos premiers secours. Tout comme les rats, un autre rongeur très sociable,
les souris pourraient ainsi être bien plus compatissantes que nous
ne l’imaginions. Les résultats, publiés dans la revue Science Advances le 21 février 2025,
suggèrent en outre que l’instinct d’aider d’autres membres de notre
espèce en détresse pourrait être profondément enraciné dans notre
héritage mammalien, ce qui remet profondément en question nos idées
reçues sur l’altruisme dans le règne animal.
Ce comportement n’est pas inconnu dans le monde animal. Des
observations de mammifères sociaux au cerveau développé portant
secours à des congénères en difficulté ont d’ores et déjà été
rapportées. Par exemple, les chimpanzés sauvages touchent et
lèchent leurs pairs blessés, les dauphins peuvent tenter de pousser
un compagnon en détresse vers la surface pour lui permettre de
respirer et des éléphants apportent leur aide à des proches
malades. Cependant, les comportements assimilables aux premiers
secours n’avaient jamais été étudiés en détail chez de plus petits
mammifères, ce qui rend cette étude particulièrement
fascinante.
Des souris qui portent secours à leurs compagnons inanimés
Une équipe dirigée par Wenjian Sun, de l’Université de
Californie du Sud à Los Angeles (États-Unis), a mené une série
d’expériences pour observer comment les souris réagissent face à
des congénères inertes dans des conditions de laboratoire
contrôlées. Les chercheurs ont placé des souris dans des cages avec
des compagnons inconscients, immobiles ou décédés, et ont analysé
leur comportement. Sur une période de treize minutes d’observation,
les rongeurs ont consacré en moyenne 47 % de leur temps à interagir
avec leur compagnon inconscient en trois types de comportements
distincts.
Si elles reconnaissaient leur congénère, les souris prenaient
particulièrement soin de lui : elles s’approchaient, le reniflaient
et lui léchaient le pelage. Un comportement frappant a été observé
: elles se concentraient particulièrement sur le visage et la gorge
de l’animal en lui léchant les yeux ou mordillant sa bouche. En
voyant ce compagnon rester de plus en plus inerte, la souris
secouriste adoptait ensuite des gestes plus énergiques. Dans plus
de la moitié des expériences, elle allait jusqu’à tirer la langue
de l’animal inconscient hors de sa bouche afin de dégager ses voies
respiratoires. Lorsqu’un corps étranger (comme une petite bille en
plastique) était placé dans la bouche de la souris inconsciente, la
souris aidante le retirait dans 80 % des cas avant de s’attaquer à
la langue. Ces tentatives de réanimation ont également été
observées sur des souris mortes, mais pas sur celles qui dormaient
simplement.
Autre fait marquant : les souris anesthésiées ou sédatées qui
ont bénéficié de cette assistance se réveillaient plus rapidement
que celles non secourues. Et dès qu’elles retrouvaient conscience,
les souris aidantes cessaient immédiatement leur intervention, ce
qui montre clairement qu’elles ne portaient secours que lorsque
cela était nécessaire.
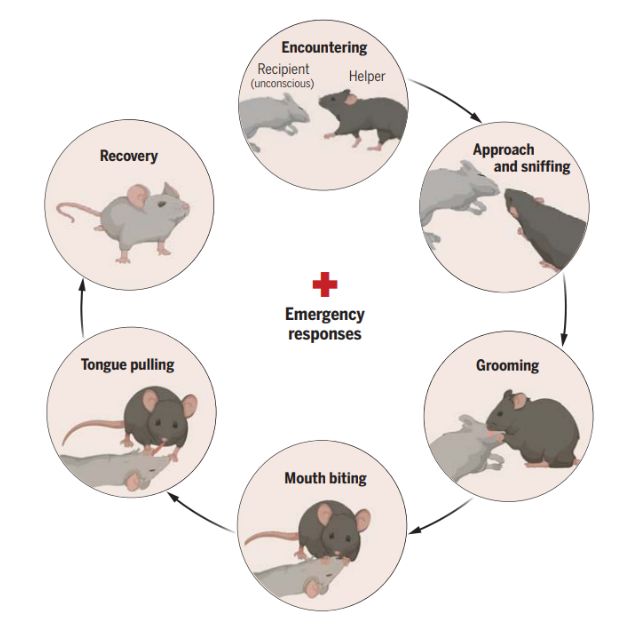
Crédits : Sun et coll. Science, 2025.Pourquoi un tel comportement chez les souris ?
L’une des grandes questions soulevées par cette étude était de
savoir si ces actions relevaient d’un simple réflexe ou si elles
témoignaient d’une véritable compréhension de la détresse. Pour y
répondre, les chercheurs ont répété l’expérience sur cinq jours et
ont constaté que les souris continuaient invariablement leurs
tentatives de réanimation. De plus, elles étaient bien plus
enclines à aider un compagnon familier plutôt qu’un étranger, un
résultat cohérent avec les recherches antérieures sur les liens
sociaux et l’empathie chez les animaux.
Bien qu’il soit difficile de déterminer avec certitude si les
souris comprennent réellement les conséquences de leurs actions,
leur préférence pour les individus connus et la répétition des
gestes de secours sur plusieurs jours suggèrent qu’il s’agit de
bien plus qu’un simple comportement automatique, de curiosité ou
d’une simple volonté d’interaction sociale réciproque. Par
ailleurs, le sexe des souris ne semblait pas influencer ce
comportement.
Dans un commentaire publié dans la revue Science, William
Sheeran et Zoe Donaldson, de l’Université du Colorado à Boulder
affirment d’ailleurs que ces comportements rappellent la manière
dont les humains sont formés à dégager les voies respiratoires lors
d’une réanimation cardio-pulmonaire. Selon eux, il s’agit
vraisemblablement d’un comportement social inné partagé par de
nombreuses espèces.
Que se passe-t-il dans leur cerveau ?
Ces recherches se sont également penchées sur la base
neurologique de ce comportement de secours. Des scanners cérébraux
ont montré qu’en présence d’un congénère inconscient, l’amygdale
médiane (une région du cerveau impliquée dans le traitement social)
s’activait fortement. Les chercheurs ont également détecté une
forte augmentation du taux d’ocytocine, souvent surnommée l’hormone
de l’amour, dans le cerveau des souris secouristes. Or, l’ocytocine
joue un rôle crucial dans les liens sociaux, le soin maternel et
l’empathie, ce qui renforce l’idée que ces comportements de
sauvetage pourraient effectivement être motivés par des liens
émotionnels et sociaux plutôt que par un simple instinct.
Fait intéressant : une région cérébrale différente était activée
lorsque les souris interagissaient avec un compagnon stressé, mais
toujours conscient. Cette distinction suggère que les souris
pourraient posséder des circuits neuronaux spécialisés pour
répondre à différents types de détresse, qu’elle soit émotionnelle
ou physique. Les comportements observés et données récoltées
laissent en tout cas penser que ces rongeurs possèdent une forme
primitive de compassion, autrefois pourtant considérée comme
l’apanage des humains et des mammifères les plus intelligents.
Vous pouvez découvrir l’étude en détail en suivant ce lien.
