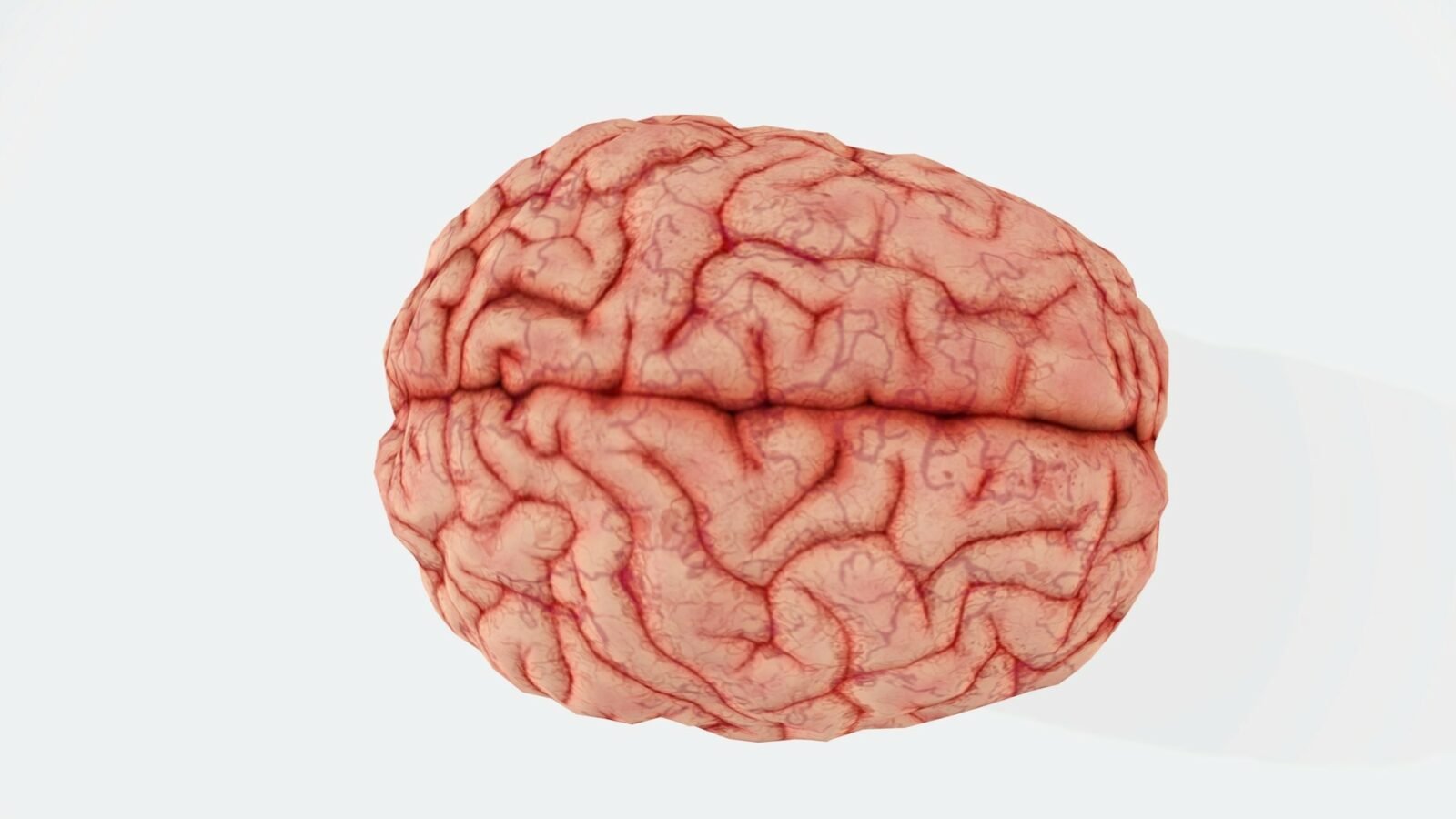L’autisme, aujourd’hui qualifié de trouble du spectre de l’autisme (TSA), est défini par santé.gouv comme étant un « un trouble neuro-développemental précoce [qui] se manifeste par des troubles de la communication, des intérêts ou activités obsessionnels, des comportements à caractère répétitif, ainsi qu’une forte résistance au changement », précisant que « ces signes s’expriment avec des intensités variables ». L’association Autisme France estime, dans cette publication, que cette condition touche, dans notre pays, « entre 1 % et 2 % de la population […] soit environ un million de personnes ».
Devant une telle prévalence, les chercheurs et cliniciens s’interrogent : comment un trouble potentiellement si handicapant a-t-il pu persister dans la population humaine sans être éliminé par la sélection naturelle ? Selon cette étude parue le 9 septembre dans la revue Molecular Biology and Evolution, publiée par l’Université d’Oxford, il faudrait prendre cette question à l’envers. L’autisme pourrait être, au contraire, le « prix évolutif » à payer pour les traits qui font de nous des humains : la créativité ou le langage, par exemple.
Un développement neuronal sous pression évolutive
Pour comprendre cette hypothèse, il faut d’abord comprendre la méthodologie que les chercheurs ont employée. Afin d’y voir plus clair sur la question, ils ont exploité les données de séquençage de noyaux neuronaux (une technique qui permet d’analyser l’activité des gènes à l’intérieur de chaque cellule nerveuse), en comparant plusieurs espèces de mammifères.
Ils ont centré leur analyse sur un type particulier de cellules cérébrales : les neurones dits L2/3 IT. Ces cellules nerveuses sont situées dans la deuxième et la troisième couche du cortex cérébral, la partie la plus évoluée de notre cerveau, siège de fonctions cognitives complexes comme le langage, la mémoire ou la perception.
Très abondants, ils sont essentiels au bon fonctionnement des circuits cérébraux supérieurs, des réseaux de neurones qui nous confèrent des capacités cognitives plus avancées que les autres espèces animales. Les chercheurs ont découvert que chez Homo sapiens, ces neurones ont évolué bien plus rapidement dans notre lignée que nos cousins primates les plus proches, comme les chimpanzés ou les bonobos.
Une accélération qui se serait accompagnée de profondes modifications dans certains gènes connus pour être liés à l’autisme. Ce seraient donc ces petites variations génétiques, qui, sélectionnées au cours de l’évolution, auraient contribué à rendre notre cerveau plus « puissant », mais également plus vulnérable à certains troubles neurodéveloppementaux. « Nos résultats indiquent que les mêmes gènes qui rendent notre cerveau unique ont aussi rendu les humains plus neurodivergents », explique l’auteur principal de l’étude, Alexander L. Starr.
Le revers biologique de nos capacités intellectuelles
Pourquoi de tels gènes auraient-ils été favorisés par la sélection naturelle ? Si l’on y réfléchit bien, cela semble presque contraire aux règles de la pression sélective, théorisées par Darwin au XIXᵉ siècle. L’hypothèse avancée par les chercheurs est que beaucoup d’entre eux sont directement reliés aux délais de maturation neuronale ; le temps nécessaire aux cellules du cerveau pour arriver à maturité. Contrairement aux chimpanzés, dont le cerveau atteint sa pleine capacité plus rapidement, l’être humain connaît un développement postnatal bien plus long.
C’est pourquoi les nourrissons restent plus longtemps dépendants de leurs parents, mais cette période est extrêmement précieuse pour leur évolution. Elle permet un apprentissage plus progressif, une plasticité cérébrale (la capacité du cerveau à se modifier au fil des expériences) plus efficace et, par conséquent, le développement du langage, un processus qui exige des années de travail cognitif.
Le TSA serait donc uune conséquence directe, un corollaire biologique, des mutations génétiques qui ont permis à notre cerveau de devenir plus souple et plus adaptable. Pour autant, cette lecture évolutive proposée par cette équipe de chercheurs ne prétend pas être l’unique explication de cette condition. Elle reste, comme tous les autres angles sous lesquels on peut aborder cette thématique, un cadre d’analyse, qui ne doit pas occulter les autres (social, éducationnel, culturel, etc.). Nous ne devons pas enfermer ce trouble, complexe et multifactoriel dans une perspective purement biologique, une erreur d’appréciation qui risquerait de réduire ce trouble à une « anomalie » génétique. Même si d’autres travaux viendront certainement nuancer ou compléter ce cadre, l’importance de cette découverte est indéniable : nos fragilités neurologiques sont intimement liées à nos plus grandes forces adaptatives.
- Une étude génétique suggère que certains gènes associés à l’autisme ont évolué rapidement chez l’être humain, en parallèle du développement du langage et de la pensée complexe.
- Ces mutations auraient favorisé un cerveau plus lent à se développer, mais plus flexible et capable d’apprentissage approfondi, au prix d’une plus grande vulnérabilité à certains troubles.
- L’autisme ne serait donc pas une simple anomalie, mais l’une des conséquences possibles des compromis évolutifs qui ont façonné notre singularité cognitive.
📍 Pour ne manquer aucune actualité de Presse-citron, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.