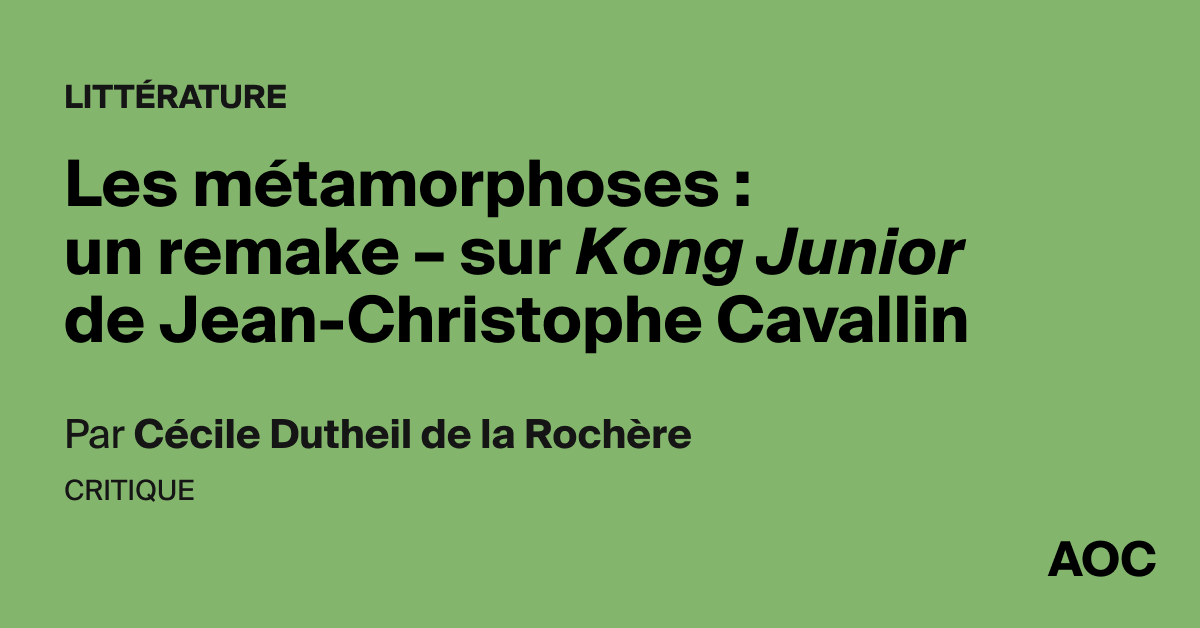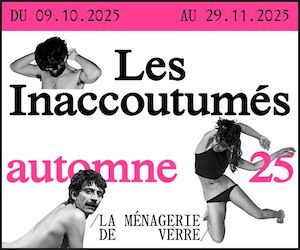Les métamorphoses : un remake – sur Kong Junior de Jean-Christophe Cavallin
King Kong, demi-humain, est mort dans un asile pour fous sur l’île de Poveglia, au large de Venise. Son petit-fils est embauché par l’artiste du pavillon belge de la Biennale pour se pavaner avec un paon. L’animal et l’humain débordent leurs frontières, le rationnel est devenu fou, le roman aussi. Descartes a rendu le monde « corvéable à merci » et désert. Le dernier roman de Jean-Christophe Cavallin baigne dans un climat lourd d’éco-anxiété. Venise sera un jour engloutie, peu importe les digues ou l’humour de l’auteur.
Est-ce une folie, une rêverie, un cauchemar éveillé, un délire semé de références plus ou moins voilées ? D’emblée, le récit de Jean-Christophe Cavallin déroute et sème le doute. L’auteur de Kong Junior est pourtant connu du public pointu de la recherche et de l’université, même s’il est inconnu du grand public. Il est à la proue de l’écocritique et du renouvellement de l’approche de la littérature que celle-ci a initiée. Mais cette fois-ci, il a lâché, « désamarré », comme il l’écrit.
Il a abandonné la théorie et la raison, glissé dans l’imaginaire et l’onirisme, et suivi sa main d’écrivain-poète. Et il s’est téléporté dans la ville la plus artificielle et la plus fragile du monde, Venise. Alors traversons, enjambons les ponts, et entrons dans ce très extravagant palazzo d’images, d’idées et de savantes arabesques.
Le récit lui-même est très découpé et structuré. Il a beau être fantasque, il ne se présente pas comme une longue coulée qui déroulerait toutes sortes de pensées et de fantasmes. Il est fait de morceaux de prose qui se répondent, se contredisent et se redisent ; de bouts de dialogue ; d’esquisses de calligrammes ; de bribes de méditations ; de repères subrepticement cachés dans le texte, qui peu à peu construisent un sens et dégagent une voie plus claire.
L’ouverture est limpide, et assez magistrale. Un homme parle, qui a accepté d’être embauché par l’artiste du pavillon belge de la Biennale de Venise pour se pavaner dans la ville avec un paon. Le ton est donné, suivent quelques pages d’une écriture flamboyante et moqueuse, au fil de laquelle on perçoit un regard très averti sur l’inventivité et l’insolence des acteurs de l’art contemporain, mais aussi sur leur fatuité, leur cynisme et leur alliance avec le marché, le tourisme de masse et les paillettes argentées. Notre drôle de narrateur se nomme Lucio Pavone : on y entend Luciano Pavarotti et la note kitsch liée à ce ténor à l’immense popularité, on y apprend que paon se dit pavone en italien