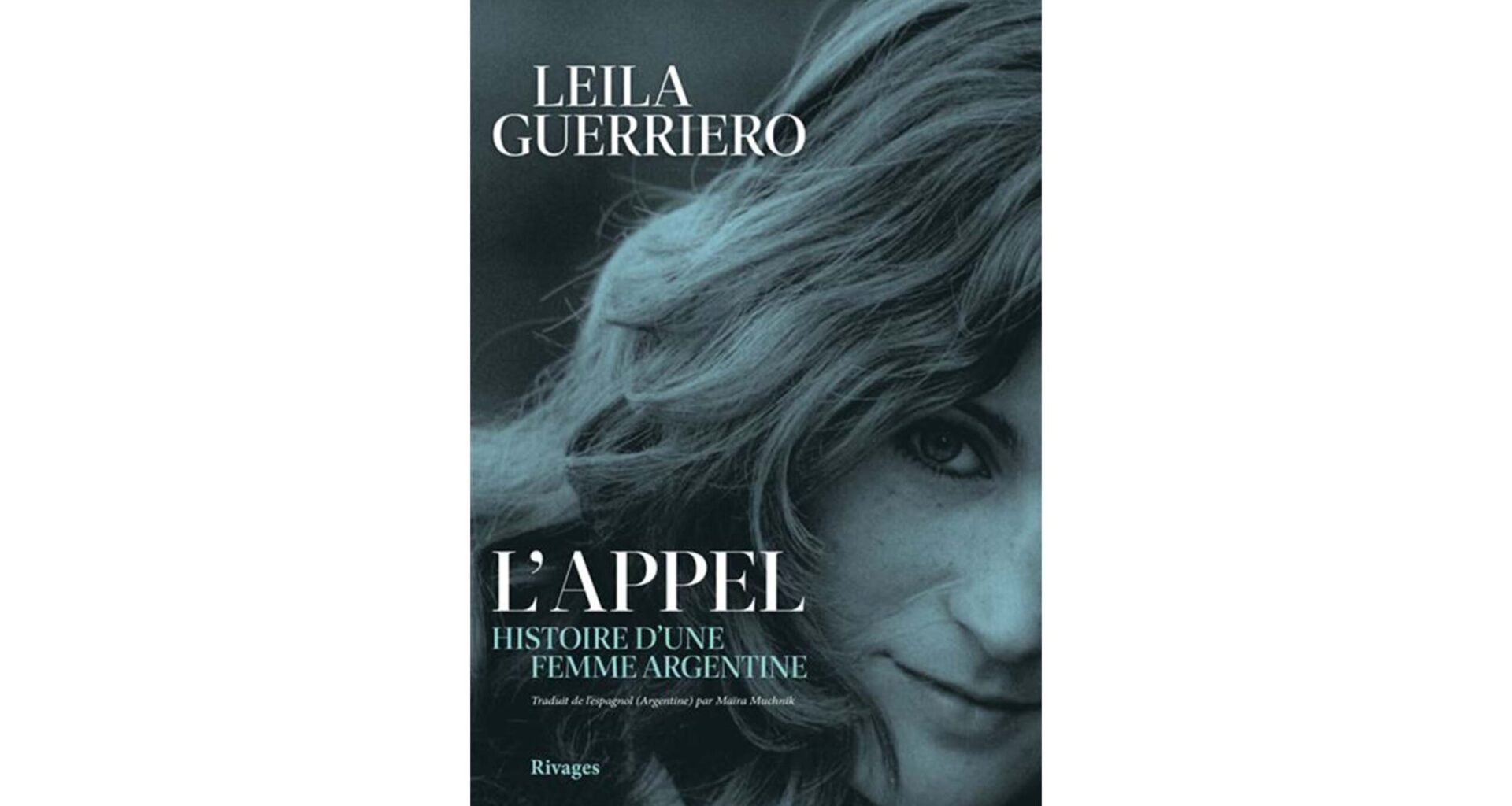Titre : L’Appel
Auteur.ice : Leila Guerriero
Editions : Rivages
Date de parution : 20 août 2025
Genre du livre : Biographie
Dans L’Appel, la journaliste et autrice Leila Guerriero s’attelle à un exercice périlleux : relater la vie de Silvia Labayru, militante péroniste d’extrême gauche, membre du mouvement des Montoneros, engagée dans la lutte contre la junte militaire qui s’impose en Argentine.
Enlevée, détenue et torturée dans le sinistre centre de détention de l’ESMA (École de mécanique de la marine), Silvia fait partie de ces survivantes dont l’existence même dérange. Sa survie, perçue comme une trahison par ses anciens camarades, devient un stigmate : vivre, c’est déjà suspect.
La mémoire impossible
L’autrice dresse le portrait d’une femme forte, parfois distante, parfois passionnée. Une femme aux yeux clairs, à la blondeur sophistiquée. Une femme à la mémoire tantôt précise, tantôt sélective. En 1976, Silvia est arrêtée. Durant un an et demi de captivité, elle est torturée, violée, accouche en détention, puis est relâchée — parce qu’elle a su feindre, suffisamment bien, la rééducation forcée imposée par ses bourreaux. À sa sortie, elle s’exile à Madrid. Là, ses anciens camarades montoneros la rejettent : sa libération est perçue comme une preuve de trahison. Sa survie, à elle seule, devient une condamnation. « Si elle est sortie, c’est qu’elle nous a trahis. »
Jusqu’alors, Silvia s’était très peu exprimée. Hormis quelques mots laconiques lors du procès de ses bourreaux en 2010, elle était restée silencieuse. Elle accepte pourtant de se confier à Leila Guerriero, qui aborde cette relation comme une danse à deux temps. Observatrice, elle se tient à la fois dedans et en dehors, interrogeant aussi les proches, les amis, les témoins. Ces entretiens, menés pendant la période du Covid, bénéficient du temps suspendu du confinement. Presque religieusement, l’autrice construit son portrait, à mi-chemin entre un reportage rigoureux et une fresque humaine, où Silvia occupe toute la scène.
Le chaos comme langage
Ce qui déroute le plus dans ce livre, c’est sa forme. L’autrice ne construit pas un récit linéaire, mais une mosaïque d’impressions, de fragments, de contradictions. Comme si elle ouvrait son carnet de notes. Pas de chapitres, mais une succession de paragraphes discontinus, de voix qui se croisent — celle de Silvia, celle de la journaliste, celles des témoins.
On lit ce livre comme on écouterait une bande magnétique abîmée, d’où émergent, par bribes, des éclats de vérité. Ce désordre n’est peut-être pas qu’un choix stylistique : il reflète peut-être le chaos d’une mémoire traumatique, un désordre de pensée. Peut-être aussi que ce phrasé, ce rythme, ces mots choisis, tiennent compte de la musicalité de la langue d’origine — l’espagnol.
On y ressent une oralité latine, presque almodovarienne : dans les récits de table, les descriptions de lieux de vie, les détails apparemment insignifiants, comme s’il fallait tout consigner pour faire surgir, dans l’esprit du lecteur, l’image exacte vécue par l’autrice.
Ce choix narratif — ces entrelacs de voix, ces incursions géopolitiques parfois abruptes, cette absence de structure ou de chronologie — peut désarçonner. Il rend l’entrée dans le récit plus difficile, l’empathie plus ardue. Mais il dit aussi quelque chose du réel : de sa complexité, de son opacité, de sa fragmentation.
Une voix parmi d’autres, mais une voix debout
Le résultat est un ouvrage profondément organique, résolument inclassable : ni biographie, ni enquête, ni roman, mais un entrelacs de mémoire et de sensations, où l’ordre importe moins que la persistance de la voix. Celle de Silvia, bien sûr, mais aussi, à travers elle, celle de toutes les victimes silencieuses. Et de toutes ces femmes qui, malgré les épreuves, continuent à marcher la tête haute, le verbe fort.