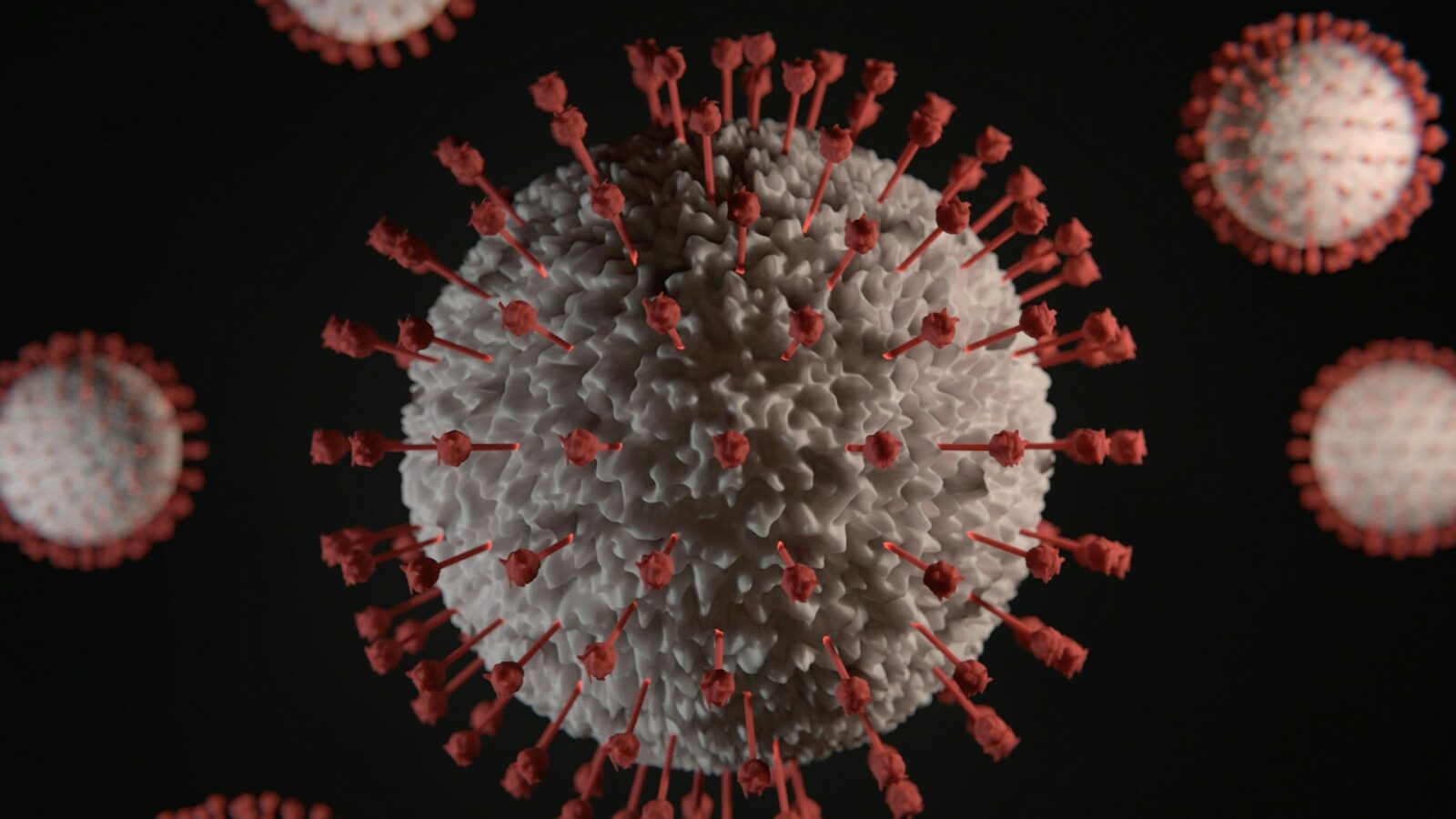La pandémie de SARS-CoV-2 sera-t-elle un jour totalement sous contrôle, ou est-ce un virus avec lequel nous devrons apprendre à vivre ? Une interrogation que les meilleurs épidémiologistes du monde n’arrivent pas à trancher, tout comme celle de l’origine de la persistance des effets post-guérison chez certains patients (le fameux « COVID long »). Fatigue, troubles cognitifs ou atteintes cardiaques, des séquelles aujourd’hui bien documentées, qui concernent une faible portion de la population qui a été infectée lors des différentes vagues.
Néanmoins, pour la toute première fois, une équipe de chercheurs du Florey Institute of Neuroscience and Mental Health (Université de Melbourne) a mis en évidence une possible hérédité épigénétique induite par le virus (transmission biologique sans modification de l’ADN lui-même). Leur étude, publiée le 11 octobre dans la revue Nature Communications, a mis en évidence que chez des souris mâles infectées, le virus altère la régulation de gènes clés dans leur sperme, lesquels influencent ensuite la formation du cerveau de leur progéniture.
Un effet du virus transmis de père en fils, sans mutation génétique
Pour mener à bien leurs travaux, les chercheurs ont volontairement infecté des souris mâles avec le virus, avant de procéder à leur accouplement avec des femelles non porteuses du virus. « Nous avons constaté que leur descendance présentait davantage de comportements anxieux que celle issue de pères sains », explique l’autrice principale de l’étude, Elizabeth Kleeman. Selon l’équipe, toutes les portées de souriceaux issus de ces couples mâles infectés/femelles saines laissaient apparaître des signes de modification comportementale.
Principalement chez les jeunes femelles, les chercheurs ont observé une activité génétique anormale dans l’hippocampe. Une structure cérébrale essentielle chez tous les mammifères, qui gouverne la mémoire, la régulation émotionnelle, la conscience spatiale ou encore l’apprentissage.
Pour Carolina Gubert, co-autrice de l’étude, cette altération des gènes dans cette zone du cerveau a forcément un lien avec l’anxiété observée chez les lignées concernées. « Cela pourrait contribuer à l’anxiété accrue que nous avons observée chez les descendants, en raison d’une transmission épigénétique et d’un développement cérébral modifié », précise-t-elle. L’infection virale pourrait laisser une « empreinte biologique », transmise uniquement par le père, qui influencerait ensuite les générations suivantes, avant même leur naissance.
Des traces du virus détectées dans les molécules d’ARN du sperme
Le dénominateur commun de ces effets étant la transmission paternelle, les chercheurs ont soupçonné le sperme d’être le support de la trace biologique laissée par le virus et l’ont donc analysé. Comme tout fluide corporel, le sperme contient une multitude de molécules, dont l’ARN (Acide ribonucléique), une molécule qui sert de messager, transportant les informations génétiques contenues dans l’ADN pour la fabrication des protéines et la régulation cellulaire.
Les chercheurs ont découvert que l’infection virale modifiait l’expression de diverses molécules d’ARN contenues dans le sperme des mâles. Or, il s’avère que certaines d’entre elles régulent l’activité de gènes fondamentaux pour la construction et le développement du cerveau. En altérant ces messagers, le virus pourrait indirectement influencer la façon dont le cerveau des souriceaux se développe. Des résultats qui confirment bien le lien épigénétique : même si le virus ne modifie pas le code génétique, il influence l’interprétation de l’ADN par les cellules, créant ainsi une forme de « mémoire biologique héréditaire ».
Pour le moment, l’équipe insiste bien sur le fait que ces observations ne sont pas encore extrapolables chez l’humain, même si cette probabilité n’est pas à écarter. Si l’hypothèse avancée par l’équipe devait un jour se confirmer, les effets décelés par l’équipe pourraient concerner « des millions d’enfants dans le monde », selon Anthony Hannan, chercheur principal de l’étude. Par conséquent, d’autres travaux seront nécessaires pour déterminer si cette empreinte épigénétique existe aussi chez l’humain, ou si elle concerne uniquement le modèle murin. Le COVID-19 serait alors le premier virus connu à induire une modification héréditaire du comportement, sans mutation génétique détectable. Un tel constat nous obligerait à intégrer le facteur épigénétique dans le concept de transmission, absent de la vision classique de l’hérédité qui a dominé la biologie depuis l’ère darwinienne.
- Des chercheurs australiens ont observé que des souris mâles infectées par le SARS-CoV-2 transmettent à leur descendance une prédisposition à l’anxiété, sans altération de l’ADN.
- L’origine de cet effet serait une modification des molécules d’ARN présentes dans le sperme, qui perturberaient l’expression de gènes liés au développement cérébral.
- Ces effets n’ont été observés que chez des souris, et il n’est pas encore possible de les confirmer chez l’humain.
📍 Pour ne manquer aucune actualité de Presse-citron, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.