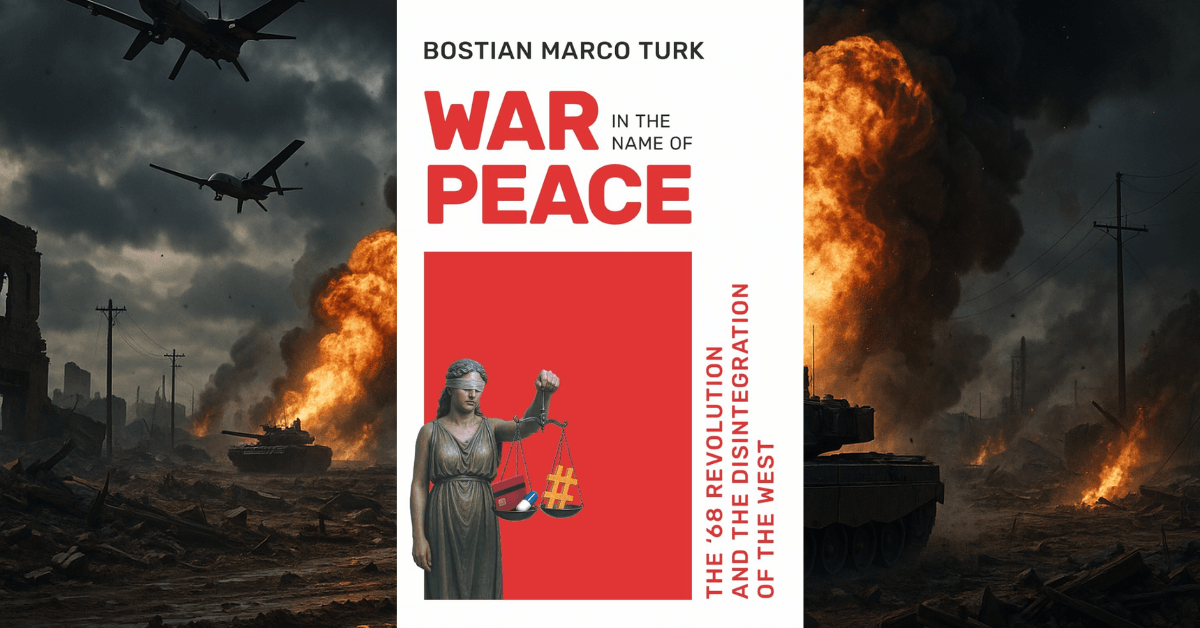![]() Imprimer l’article
Imprimer l’article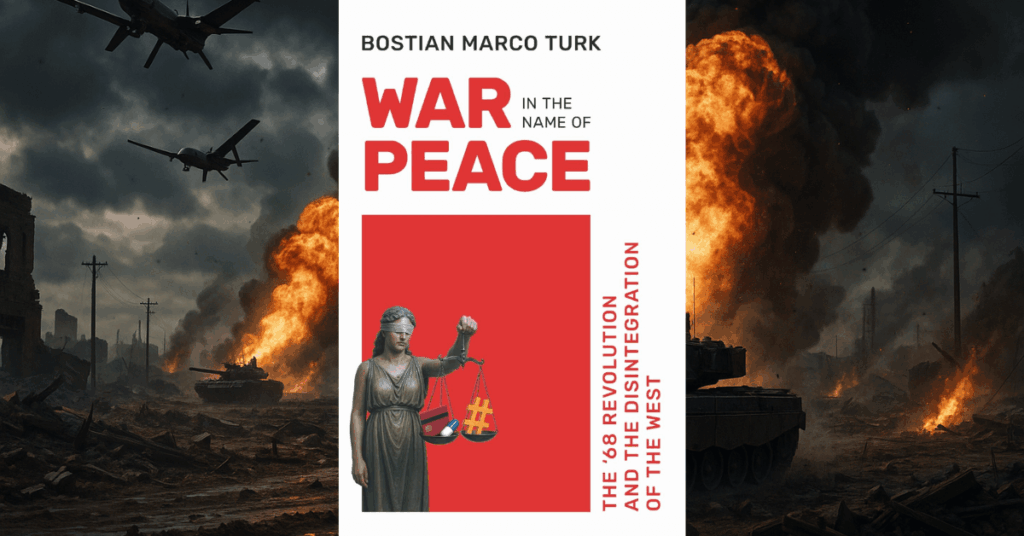 Réalisation Le Lab Le Diplo
Réalisation Le Lab Le Diplo
Par Sébastien Marko Turk, Professeur universitaire et Doyen de la première Classe (Humanités) de l’Académie Européenne des Sciences et des Arts
Le livre La Guerre au nom de la Paix (édition anglaise) récemment publié par Arktos à Londres, propose une réflexion critique sur les fondements idéologiques de l’Europe bruxelloise et sur les fausses illusions de l’univers occidental. L’ouvrage soutient que le monde moderne demeure enfermé dans un cadre intellectuel hérité du XIXᵉ et du XXᵉ siècle, lorsque le marxisme et le freudisme s’imposèrent comme paradigmes dominants de la compréhension de l’homme.
Ces doctrines, bien que distinctes, convergent dans une même réduction : celle de l’être humain privé de son essence spirituelle, de sa liberté intérieure et de sa transcendance. Marx conçoit l’homme comme un produit des rapports sociaux et des forces économiques, tandis que Freud le définit comme un être gouverné par les instincts et les pulsions inconscientes. De cette double dénaturation naît la structure idéologique de l’Europe moderne. Qu’est-ce que c’est Bruxelles d’autre qu’un appareil administré, technocratique et culturellement nihiliste ? Et, en conséquence, l’Europe un continent où l’homme se trouve amputé de sa dimension métaphysique ?
Cette perte de transcendance trouve un écho dans la crise de l’autorité politique, illustrée par le concept des « deux corps du roi », théorisé par Ernst H. Kantorowicz. Inspiré du dogme christique des deux natures – divine et humaine, subsistant en Christ, ce modèle attribue au souverain un corps physique, mortel, et un corps mystique, immortel, incarnant la continuité de l’État et l’intérêt commun. Le régicide de Louis XVI en 1793, qualifié par Albert Camus de « désacralisation de l’histoire », a brisé cette autorité métaphysique, ouvrant la voie à une modernité où les intérêts particuliers priment sur l’intérêt collectif.
À lire aussi : TRIBUNE – Éloge de la sécession
Avec la mort d’Élisabeth II en 2022, l’Occident a perdu une des dernières figures incarnant cette vision : une souveraine dont le règne symbolisait l’unité et la défense des intérêts nationaux, transcendant les contingences politiques par sa légitimité historique. Vous souvenez-vous d’une chose qu’elle aurait faite pour elle-même, dans son propre intérêt ? Non. Mais avancez d’une, deux générations. Le roi Charles est devenu notoire par ses histoires érotiques, de Diana à Camilla. Qu’a-t-il jusqu’à présent fait pour la monarchie ? Quant au prince Harry et à Meghan Markle, ils ne semblent s’occuper que d’eux-mêmes.
Poursuivant ce modèle, les dirigeants actuels, souvent perçus comme les relais des agendas de Bruxelles, des multinationales ou d’influences comme celles de George Soros, privilégient des intérêts supranationaux, délaissant les peuples qu’ils devraient servir.
C’est précisément dans cette perspective que s’impose le contrepoint de Göbekli Tepe. Qu’a un site archéologique à faire dans tout cela ? Beaucoup, comme on verra. Il s’agit notamment d’un lieu historique situé dans le sud-est de l’Anatolie, âgé de plus de 11 000 ans, et considéré comme le plus ancien sanctuaire connu au monde. Ses puissants piliers en forme de T, ornés de reliefs d’animaux, montrent que dès le Néolithique ancien, les êtres humains se rassemblaient pour des rituels religieux et le culte du divin, plutôt que pour des besoins pratiques de survie. Son importance est immense, car il transforme notre compréhension des débuts de la civilisation : ce ne fut pas l’agriculture, mais bien la foi et le monde symbolique qui unirent pour la première fois les hommes en une société organisée.
À lire aussi : HISTOIRE – Saint Michel, patron des paras : Histoire et symbolique militaire d’une fraternité d’armes
De cela, nous concluons que l’essence de l’homme n’est pas matérielle, mais spirituelle. Cette découverte contredit directement la thèse marxiste selon laquelle « les rapports économiques déterminent la conscience individuelle, c’est-à-dire la spiritualité ». Les faits archéologiques montrent le contraire : la conscience – c’est-à-dire la perception symbolique et spirituelle du monde – est ce qui crée l’économie et les structures sociales. La culture précède la production, la foi engendre la communauté.
Klaus Schmidt, directeur des fouilles, résumait cette inversion par une formule célèbre : « L’homme a bâti des temples avant de bâtir des maisons. » Autrement dit, la société humaine s’est d’abord constituée autour du sacré, avant de s’organiser autour du nécessaire (du secteur économique, mutatis mutandis). L’erreur du matérialisme marxiste tient à son effort d’expliquer la spiritualité par la matière, oubliant que c’est l’esprit qui rend le monde intelligible. À Göbekli Tepe, le rapport marxiste entre la base et la superstructure se trouve entièrement renversé : la base n’est pas économique, mais symbolique ; la superstructure n’est pas issue de la foi, elle est la foi elle-même, principe constitutif de l’existence humaine.
Et où en sommes-nous aujourd’hui, perdus dans le consumérisme et imprégnés de tous les poisons possibles : tranquillisants, somnifères, antidépresseurs ; alcool, cocaïne, marijuana ou pire encore? Et avec le marxisme, combiné au consumérisme, devenu doctrine officielle de l’UE? L’ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, natif du Luxembourg, a ainsi – certes sur des jambes quelque peu fragiles – inauguré symboliquement un monument à Karl Marx dans son pays natal, ce qui a provoqué de vives réactions car ce geste a été interprété comme une reconnaissance de l’héritage marxiste qui aujourd’hui façonne la politique de Bruxelles.
À lire aussi : TRIBUNE – La diplomatie au péril de la dispersion
Cette influence idéologique se manifeste concrètement dans plusieurs domaines : les régulations économiques centralisées, les politiques sociales uniformisées, l’éducation harmonisée et, plus encore, la répression implicite ou explicite de toute religion. Bruxelles apparaît aujourd’hui plus athée que ne l’était Tirana sous Enver Hoxha, l’athéisme étant dans les deux cas la pratique fondamentale de la vie quotidienne, prévue et encadrée par des lois et des actes législatifs. L’ensemble crée un cadre où les États membres se trouvent de plus en plus contraints par des normes supranationales, au détriment de leur autonomie, de la diversité culturelle et de la liberté spirituelle de leurs peuples.
C’est pour cette raison que, transposée dans le contexte contemporain, la grande leçon archéologique éclaire la dérive actuelle de l’Europe. L’Union européenne, par sa gouvernance technocratique, bureaucratique et rationaliste, reproduit la même erreur de fond : la substitution de l’ordre spirituel par un ordre administratif. Bruxelles incarne désormais la figure d’un pouvoir sans transcendance, d’une autorité procédurale privée de substance. Sous les bannières du « progrès » et de l’« inclusion », s’effacent la continuité historique, les identités nationales et les traditions religieuses. Cette perte de transcendance rappelle le régicide de Louis XVI, qui, selon Camus, a marqué la rupture avec l’autorité métaphysique du roi, dont le corps mystique garantissait l’ordre social et spirituel. En supprimant le souverain, on a ouvert la voie à une modernité où les intérêts particuliers, aujourd’hui représentés par les agendas de Bruxelles ou des multinationales, priment sur l’intérêt commun.
Cette crise s’accentue avec l’absence de figures capables d’incarner l’unité nationale, un rôle que la dernière reine britannique a tenu jusqu’en 2022, contrairement aux leaders actuels, souvent perçus comme des relais d’influences économiques ou idéologiques supranationales. Cette idéologie, fondée sur la foi dans la raison technique et l’humanisme séculier, prolonge en réalité l’héritage du marxisme : la conviction que l’homme peut être redéfini en rompant avec toute transcendance.
Mais une telle entreprise conduit moins à l’émancipation qu’à une dépossession. L’individu perd le sens de son être et devient — selon la formule employée dans l’ouvrage La Guerre au nom de la Paix— une « catégorie économique dans un catalogue posthumaniste ». Ce déracinement s’exprime jusque dans le langage politique qui célèbre des valeurs sans enracinement : une solidarité sans mémoire, une égalité sans différence, une inclusion sans culture. Ce discours, que Habermas qualifie de « rationalisme procédural », reflète le vide spirituel d’une civilisation en perte de sens. Cette perte de sens trouve un écho dans les analyses évoquées de Kantorowicz, qui montrait comment le corps mystique du roi garantissait une hiérarchie sociale fondée sur la transcendance, un principe aujourd’hui absent chez les dirigeants modernes, qui privilégient des intérêts économiques ou idéologiques au détriment des peuples.
François Furet l’avait déjà observé dans Le passé d’une illusion (1995) : les idéologies du XXᵉ siècle, notamment le marxisme, ont légué à l’Europe un formalisme politique privé de substance spirituelle. Il écrivait que l’Europe ne croyait plus en Dieu, mais ne croyait plus non plus en l’homme. Ce paradoxe tragique trouve aujourd’hui sa confirmation dans la bureaucratie européenne, symptôme d’une civilisation qui a oublié la source sacrée de son humanité.
À lire aussi : Grand Sud: Exclusive Insight on Cultural Resistance
L’influence de Freud sur la culture contemporaine ajoute une dimension supplémentaire à cette crise. L’idée que les pensées et les actions humaines seraient le produit d’impulsions inconscientes engendre une civilisation dépourvue de responsabilité morale. Lorsque le modèle freudien se combine à la logique collective marxiste, se dessine un cadre culturel où la liberté individuelle n’a plus de place. Cette fusion réduit l’homme à une fonction — au service du système économique, de l’identité sexuelle ou d’un rôle social. De manière générale, aujourd’hui, la pulsion sexuelle freudienne est transformée en pulsion de consommation : l’homme serait la proie de son appétit insatiable pour l’achat. La société — à travers toutes les publicités, auxquelles on n’échappe que sous la surface de la mer — le pousse constamment à acquérir toujours plus.
Dans un tel monde, le plaisir devient dépourvu de sens et l’émancipation, vide d’âme. La culture « woke », avec sa rhétorique dénuée de contenu ontologique, n’apparaît, dans cette perspective, que comme le symptôme tardif de ce même processus : la politisation marxiste et la psychologisation freudienne de l’homme. La crise majeure de l’autorité, où l’homme est privé de sa verticalité spirituelle, contraste avec l’idéal du souverain, dont le corps mystique garantissait une responsabilité transcendantale envers le peuple, contrairement aux dirigeants actuels, qui semblent soumis aux diktats de puissances économiques ou idéologiques globales.
Face à cela, une alternative se dessine de plus en plus clairement au cours de la dernière décennie, que l’on pourrait appeler la « Renaissance d’Europe centrale ». Il s’agit d’un mouvement politique, culturel et spirituel incarné par les États du groupe de Visegrád — Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie. Ces nations, confrontées pendant des siècles aux totalitarismes ont développé une conscience profonde de la continuité historique et de la solidité spirituelle. La Pologne, avec son identité catholique et la mémoire de Jean-Paul II, est devenue le symbole de ce que l’on pourrait nommer « l’Europe de la transcendance ». La Hongrie, avec sa politique de souveraineté culturelle et de protection de la famille, offre un modèle opposé à Bruxelles : une civilisation enracinée, fondée sur des bases concrètes plutôt que sur des valeurs abstraites. Ce mouvement rappelle l’importance de l’autorité ancrée dans la transcendance, telle qu’illustrée par le concept des « deux corps du roi », où le souverain incarnait l’intérêt commun et non des agendas extérieurs, un rôle que les dirigeants modernes, souvent perçus comme des relais de Bruxelles ou des multinationales, ne parviennent plus à assumer.
Dans ce sens, le groupe de Visegrád représente la manifestation politique concrète de cette vérité anthropologique que révèle Göbekli Tepe : l’homme ne peut exister sans ordre sacré, sans symbole commun, sans finalité transcendante. Là où Bruxelles voit le « progrès », Visegrád perçoit la « survie de l’esprit » ; là où l’Europe prône l’« inclusion », Visegrád insiste sur l’importance de la culture et de la foi comme socles de l’identité humaine. Ces États agissent ainsi comme un correctif historique — démontrant que la modernité ne peut perdurer sans tradition et que la liberté sans transcendance conduit à la désintégration.
Marx et Freud ont tenté d’ôter cette dimension à l’homme européen, mais chaque fois qu’elle fut étouffée, elle renaissait — dans la religion, l’art, la langue et la culture nationale. L’homme qui renonce à la transcendance perd sa verticalité ; une civilisation qui la remplace par l’idéologie perd son avenir. Le régicide de Louis XVI, en brisant le corps mystique du roi, a initié ce processus de désacralisation, et la disparition d’une figure comme Élisabeth II marque la fin d’une époque où les dirigeants incarnaient encore l’intérêt commun.
Dans la conclusion de La Guerre au nom de la paix, il est affirmé que l’Europe ne survivra que si elle redécouvre son caractère originel de sanctuaire — non pas de marché, ni de bureaucratie, mais d’autel, mutatis mutandis. Alors que Bruxelles incarne l’Europe qui a oublié son âme, Visegrád représente l’Europe qui s’en souvient. Et ce souvenir — mémoire du sacré, de la transcendance, de l’homme en tant qu’être spirituel — constitue le fondement nécessaire pour reconstruire l’avenir.
L’Europe ne pourra perdurer que si elle parvient à combiner ces deux dimensions : la vérité archéologique de l’homme comme être religieux et la sagesse politique des peuples qui ont conservé cette vérité. En ce sens, La Guerre au nom de la Paix n’est pas seulement un ouvrage sur le passé, mais un appel à la rénovation métaphysique de l’Europe, un retour à ce que Göbekli Tepe a révélé dès l’origine : la civilisation ne naît pas de la production de biens matériels, mais du sacré, tout comme l’autorité véritable, incarnée autrefois par le corps mystique du roi, ne peut exister sans une connexion au divin et à l’intérêt commun des peuples.
À lire aussi : DÉCRYPTAGE – L’Europe face au conflit israélo-palestinien : un acteur devenu marginal ?
La Guerre au nom de la Paix est déjà paru en slovène, ukrainien, croate et anglais, et sortira en français en février 2026. Des éditions polonaise, tchèque et grecque sont également en préparation.
#Europe, #UnionEuropéenne, #Bruxelles, #Marxisme, #Freud, #Transcendance, #Spiritualité, #CivilisationEuropéenne, #PhilosophiePolitique, #HistoireDesIdées, #CritiqueDeLUE, #Souveraineté, #IdentitéEuropéenne, #Humanisme, #Métaphysique, #Civilisation, #CultureEuropéenne, #CriseDeLaModernité, #ValeursEuropéennes, #RacinesChrétiennes, #GroupeDeVisegrád, #Hongrie, #Pologne, #HistoireEtPhilosophie, #GöbekliTepe, #ReligionEtPolitique, #EuropeSpirituelle, #Monarchie, #Kantorowicz, #Camus, #PhilosophieContemporaine, #CritiqueDuProgrès, #Occident, #SébastienMarkoTurk, #Arktos, #GuerreAuNomDeLaPaix, #Désacralisation, #RenaissanceEuropéenne, #Postmodernité, #EuropeDeLEsprit, #LivrePhilosophique,