« Ah Strasbourg ? Oui, tu vas en Allemagne, quoi ! » Si tu emménages dans la région pour tes études ou pour un nouveau boulot, tu as probablement déjà entendu une phrase de cet acabit. Pointe de provocation ou réelle conviction ? Certains clichés ont la peau dure. Mais comme les Alsacien(ne)s sont pédagogues, on a posé la question à des expert(e)s : alors l’Alsace… c’est pas quand même un peu l’Allemagne ?
Il se raconte que l’Alsacien(ne) serait distant(e), froid(e)… Mettons les pieds dans le plat à baeckeoffe : même franchement pas très sympa au premier abord.
Tandis que le cliché vise à dépeindre les Nordistes comme des bonnes pâtes, les Sudistes comme des gens qui savent vivre, il faut le dire : à l’Est, nous ne sommes pas bien loti(e)s.
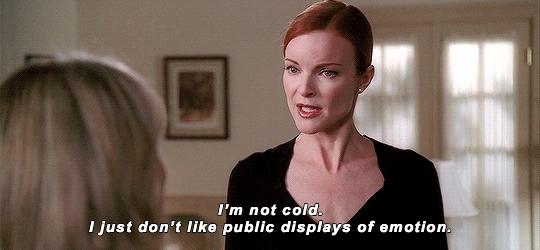 Les Alsacien(ne)s ne sont pas froid(e)s, juste un peu plus pudiques. © GIF « Desperate Housewives » / Capture d’écran
Les Alsacien(ne)s ne sont pas froid(e)s, juste un peu plus pudiques. © GIF « Desperate Housewives » / Capture d’écran
Sauf qu’en plus de tout ça, on a tendance à voir ces clichés attribués à notre côté allemand…
Alors toi, qui viens d’arriver, n’aie pas peur, inutile de gravir le col de Saverne quatre à quatre pour retourner dans cette France de l’intérieur. On va te le prouver : l’Alsace est unique !
On a donc frappé à la porte de quatre expert(e)s de sujets qui touchent à cette question de près ou de loin. Et on a demandé à ces Avengers de l’Alsace de déconstruire cette idée reçue qui nous colle à la peau. Et tu verras : si l’Alsace n’est pas exactement comme le reste de la France, on n’est pas non plus des Allemand(e)s qui s’ignorent.
 © Google / Capture d’écran
© Google / Capture d’écran
« En Alsace, on parle allemand »
Tu viens de dire ça à un(e) Alsacien(ne) ? Fuis ! Et vite : on a tendance à sous-estimer l’aérodynamisme d’une kochleffel lancée à la volée.
Pour éviter un trauma crânien inutile, on a demandé à Mélanie Marzolf, de l’Office pour la langue et les cultures d’Alsace et de Moselle (OLCA), d’éclairer notre lanterne.
 © Anthony Jilli / Pokaa
© Anthony Jilli / Pokaa
« Parmi les langues indo-européennes, [l’alsacien] fait partie du groupe linguistique des langues germaniques, auquel appartient bien sûr l’allemand, mais aussi l’anglais, le néerlandais, les langues scandinaves comme le danois, le suédois, le norvégien. »
Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut remonter jusqu’au 4e siècle : c’est à ce moment-là que les peuples germaniques s’installent autour du Rhin. Parmi eux, il y a les Francs et les Alamans. Et on cause donc leurs dialectes.
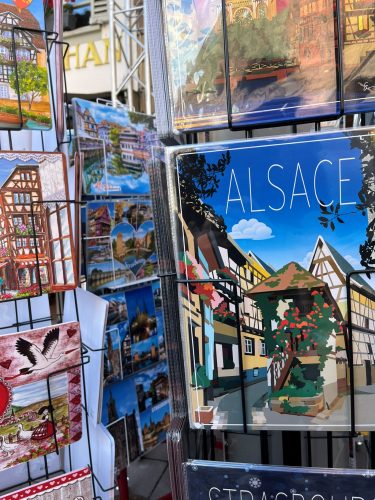

© Guillaume Rapp / Pokaa
Et l’allemand, dans tout ça ? Tout pareil : ce sont divers dialectes de peuples germains. La démarche vers une standardisation prend du temps : on ne commence à édicter les normes d’un allemand commun qu’à partir du 18e siècle.
Sauf qu’au 17e siècle, l’Alsace est rattachée au Royaume de France. On dit donc tschüss au processus de standardisation et les dialectes alsaciens évoluent en se tournant vers l’ouest : « Tout en étant une langue germanique, l’alsacien a emprunté, au cours de son évolution, des mots à la langue française, bien souvent en les ‘alsacisant’ ». On peut citer, par exemple : Bùschùr (bonjour), Orùaar (au revoir), Màmsell (mademoiselle) ou encore Pläsier (plaisir).
Selon l’OLCA, le terme « dialecte alsacien » n’est d’ailleurs qu’une abstraction : « Beaucoup d’Alsaciens se plaisent à dire qu’il existe autant de dialectes que de villes et de villages (l’Alsace compte environ 900 communes), ce qui n’est, à vrai dire, pas très éloigné de la réalité… »
Aujourd’hui, on compte cinq grandes aires dialectales : le francique rhénan (du côté de l’Alsace Bossue), le francique rhénan méridional (dans le coin de Wissembourg), le bas-alémanique du nord (Saverne, Haguenau, Strasbourg, Sélestat), le bas-alémanique du sud (autour de Colmar et Mulhouse), et le haut-alémanique (dans le Sundgau). Voilà donc l’héritage concret des Francs et Alamans du 4e siècle !
 © VUANO – Comité Vins Alsace / Document remis
© VUANO – Comité Vins Alsace / Document remis
« En Alsace, on mange allemand »
Lorsqu’on évoque la ripaille alsacienne, c’est souvent la choucroute qui vient en tête spontanément. Et il y a toujours un gros malin pour nous dire : « Mais la choucroute c’est allemaaaand. » En entendant ça, on a envie d’en découdre. Mais il parait que le savoir est la meilleure arme. Alors on s’est tourné vers une des pros en la matière : la cheffe et rédactrice culinaire Leïla Martin, autrice de plusieurs ouvrages sur la gastronomie alsacienne.
« Bien sûr, notre gastronomie est née au carrefour des cultures, avec des influences germaniques, françaises, suisses ou encore autrichiennes. Mais elle a su développer une identité propre et singulière. »
 © Julia Wencker / Pokaa
© Julia Wencker / Pokaa
Et qu’on ne vienne pas confondre les choucroutes ! Si la fermentation du chou est une technique partagée par de nombreux pays (jusqu’en Chine), la choucroute alsacienne n’a pas grand-chose à voir avec sa cousine allemande, plus acidulée : « La choucroute d’Alsace bénéficie d’une IGP (Indication Géographique Protégée), qui reconnaît son identité unique. Elle est issue de variétés locales, cultivées et transformées en Alsace, et se distingue par sa finesse, sa texture et sa saveur équilibrée. »
Et lorsqu’il s’agit de mettre en avant des mets alsaciens qui n’ont pas de véritables équivalents outre-Rhin, notre experte cite la tarte flambée, le baeckeoffe, le bibeleskäs ou encore le presskopf.
Ce qui fait l’âme de la cuisine alsacienne, ce n’est pas seulement la recette, mais la manière de la préparer, de la partager et de la relier à un terroir exceptionnel !
Leïla Martin, cheffe et rédactrice culinaire
Mais Leïla insiste : « L’Alsace, ce n’est pas seulement la choucroute garnie, la tarte flambée ou le kouglof. » Elle met en avant ces autres recettes familiales, anciennes et parfois oubliées, celles qui « racontent la créativité et le bon sens de nos aïeux, qui savaient sublimer des ingrédients simples ».
On parle alors de dampfnudle, de griesknepfle, apfelkiechle, käseknepfle, grumbeerekiechle ou fleischkiechle. Si les terminologies se ressemblent, c’est que kiechle désigne un petit gâteau (et englobe galettes et beignets) ; le terme knepfle concerne tout ce qui a une forme de quenelle ou de petite boulette.


1. © Bastien Pietronave / Pokaa ; 2. © Julia Wencker / Pokaa
Néo-arrivant(e) ? Leïla Martin te conseille d’aborder le patrimoine gastronomique alsacien par l’incontournable tarte flambée, synonyme de convivialité par excellence ! Elle recommande aussi de goûter les fleischschnacka, « plat anti-gaspi savoureux qui incarne toute l’ingéniosité de la cuisine familiale alsacienne ».
Si elle suggère enfin l’indétrônable choucroute, elle ose un pas de côté : « On la connaît surtout sous sa forme garnie avec sa cohorte de viandes et de charcuterie. Notre chou fermenté alsacien est pourtant aussi un aliment extraordinaire, riche en fibres, en vitamines et en probiotiques naturels qui mérite de trouver sa place dans notre alimentation du quotidien. » Alors place aux salades et aux déclinaisons plus légères !


© Bastien Pietronave / Pokaa
« En Alsace, on boit allemand »
Selon le baromètre Santé Public 2017, le Grand Est affiche une consommation de bière supérieure à la moyenne nationale (et une consommation de vin inférieure à la moyenne nationale). Alors oui, encore une fois, ce cliché des Alsacien(ne)s aux joues rosies qui entrechoquent leurs pintes de bière entre potes, ça fait un peu… « allemand ».
Mais puisqu’ici, on dit non aux clichés, on s’est à nouveau tourné vers une spécialiste du sujet. Élisabeth Pierre est formatrice en zythologie, autrice du Guide Hachette des Bières et de nombreux ouvrages de référence sur l’univers brassicole. Donc la bière alsacienne, elle la connait sur le bout des doigts.
 © Bastien Pietronave / Pokaa
© Bastien Pietronave / Pokaa
« Ce qui est sûr, c’est que l’Alsace a en effet une image de région de bières, parce que proche de l’Allemagne », commence l’experte. Mais elle nuance : si l’Alsace partage sa dominante de Pils et Lager légères avec l’Allemagne, cette dernière voit perdurer une forte tradition de bières de blé, les Weizen, qu’il n’y a pas en Alsace.


1. © Guillaume Rapp / Pokaa ; 2. © Vivien Latuner / Pokaa
« La présence de davantage de brasseries qui sont restées ouvertes dans le Nord-Pas-de-Calais (Hauts-de-France avec la Picardie maintenant) et en Alsace est due aussi à une culture de houblon historique. »
Chez nous, la culture du houblon remonte loin. Si l’on parle parfois d’un pasteur du 18e siècle qui aurait cultivé ses premiers plants de houblon à Oberhoffen-sur-Moder, Élisabeth Pierre note un événement fondateur : « Un peu plus tard, dans les années 1800, un brasseur installé à Haguenau ramène de Bohême 800 plants de houblon et donne ainsi naissance aux premières houblonnières modernes d’Alsace. »
Quant au brassage, l’experte souligne qu’au Moyen Âge, les abbayes de Strasbourg, Pfaffenhoffen et Wissembourg en possèdent le monopole, dès Charlemagne – on parle alors de « brassage monastique ». On brasse même… à la cathédrale.
Cette brasserie du Grand Chapitre laisse la place d’ailleurs, en 1259, à la première brasserie située près de la rue des Frères, dans l’actuelle impasse de la Bière. Le nom de son fondateur est connu : Arnoldus Cervisarius (le cervoisier), tout premier brasseur laïque.
Extrait du « Grand Dictionnaire de la Bière » d’Élisabeth Pierre dans lequel la lettre « A » est consacrée à l’Alsace.
Même si elle confirme la forte histoire brassicole du territoire, Élisabeth Pierre nuance l’idée selon laquelle l’Alsace n’est que rattachée à la bière : « Je pense que la spécificité de l’Alsace en tant que région autant viticole que brassicole est une réalité peu connue […]. Les régions historiquement brassicoles et celles historiquement viticoles sont en train d’évoluer vers une répartition plus homogène, partout. »
Pour preuve, des initiatives bousculent les frontières entre les deux univers : bières élevées en barriques de pinot noir et d’autres cépages alsaciens, réalisées avec du moût d’orge et de raisin…
Elle cite par exemple la « Perle dans les Vignes » de la brasserie Perle, ou encore le « Projet B » de la brasserie Bendorf. À goûter !


© Bastien Pietronave / Pokaa
« En Alsace, on se sent Allemand(e) »
On s’attaque ici à un vaste sujet : l’identité. Si certain(e)s ont tendance à trouver que les Alsacien(ne)s ne sont pas totalement comme les autres Français(es), c’est souvent pour nous rattacher à l’Allemagne.
Déjà, l’Alsace est française. Non, personne ne se sent Allemand(e). Personne. En revanche, l’identité alsacienne est un peu plus nuancée. On fait le point avec Pierre Jacob, ancien professeur agrégé d’histoire, contributeur d’Alsace-Patrimoine.
« Le fond de la culture en Alsace, il est germanique. Mais allemand, qu’est-ce que ça signifie ? » En fait, l’Alsace a été depuis bien longtemps un agrégat de peuples germaniques. Rien à voir avec l’Allemagne moderne certes… mais rien à voir avec la France non plus.
Les Français se sont installés au 17e siècle et ont amené de l’ordre. La France a mis en place un système administratif qui fonctionnait, après une Guerre de Trente Ans qui a fait beaucoup de mal.
Pierre Jacob, ancien professeur agrégé d’histoire
 © Fanny Soriano / Pokaa
© Fanny Soriano / Pokaa
C’est à la Révolution que se cristallise l’idée d’une identité alsacienne pas tout à fait identique à l’identité française. « On se demande alors : est-ce que le fait que ces gens-là sont de culture germanique ne porte pas obstacle à la Révolution française ? »
Un maire de Strasbourg, Savoyard, va jusqu’à préconiser la déportation d’Alsacien(ne)s pour les remplacer par des gens qui viennent des Cévennes. Le but ? Casser cette identité et faire de l’Alsace une région… comme les autres.
 © Anthony Jilli / Pokaa
© Anthony Jilli / Pokaa
Pendant les différentes périodes allemandes des deux derniers siècles, il demeure un fort sentiment francophile. En fait, il y a une chose qui a alors tendance à faire pencher les Alsacien(ne)s vers l’Allemagne : c’est l’indépendantisme. Une idée portée un temps par un binôme inédit : l’Église et les communistes.
Une nation indépendante et qui fait partie d’un empire, c’est faisable. Alors qu’avec la France jacobine, beaucoup moins.



© Marie Goehner-David / Pokaa
« Je pense qu’une identité alsacienne profondément ressentie est récente. Avant ça, j’ai cherché les traces d’une identité ressentie de l’intérieur, par les gens… en vain. »
Pierre Jacob raconte que pendant longtemps, on s’identifiait surtout selon sa ville d’origine, mais pas selon un royaume ou une tribu : « À la différence des Saxons ou des Bavarois, nos prédécesseurs n’ont pas, d’entrée de jeu, disposé d’une identité tribale. Ils ont, par contre, su très tôt qu’ils n’étaient pas des Welschs. »
Pour faire très simple, il y a d’un côté les Tütsches, peuples germaniques qui se regroupent en tribus. De l’autre côté d’une courbe qui va des îles britanniques aux Balkans, on a les Welschs. Ce sont les ancien(ne)s habitant(e)s de l’Empire romain, de langue latine ou celte.
 © Marie Goehner-David / Pokaa
© Marie Goehner-David / Pokaa
« Concrètement, un voyageur partant des rives du Rhin ou de l’Ill pouvait se rendre dans n’importe quelle partie du Saint-Empire sans avoir jamais l’impression de pénétrer dans un monde radicalement étranger. Il en était autrement lorsqu’il prenait la direction de l’ouest […]. Jusque-là, il avait été dans le tütsche Land, à présent, il entrait en terre welsch. »
Et les premiers Welschs, les premiers étrangers, auxquels les Alsaciens sont confrontés… ce sont les Lorrains ! Tiendrait-on le début d’une explication sur cette éternelle rivalité ?

