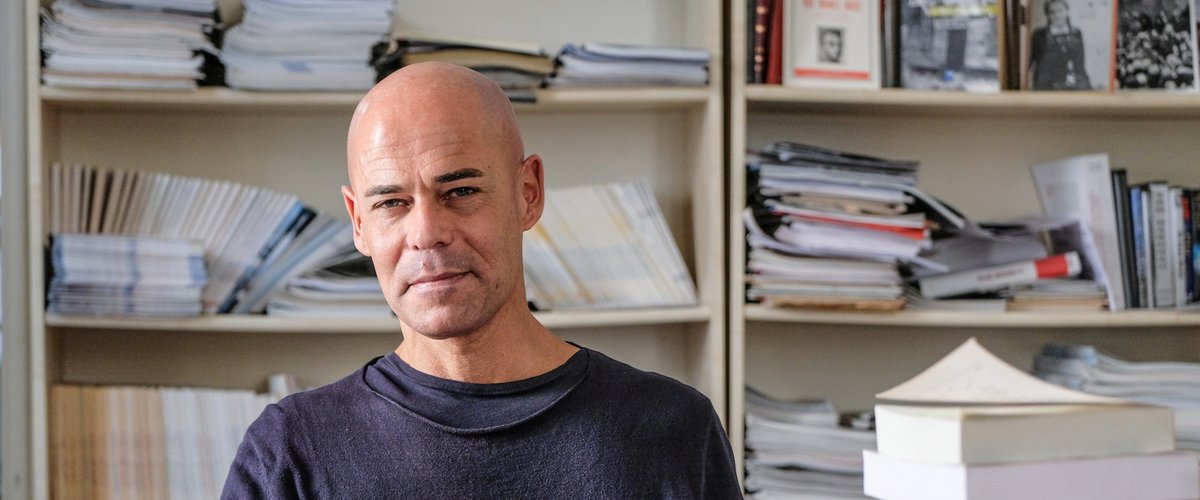L’Institut Maïmonide Averroès Thomas d’Aquin, qui a fêté ses 25 ans cette année, débute une nouvelle saison à Montpellier, sous le signe du dialogue interreligieux, comme le souhaite son directeur.
Qu’est-ce qui vous a guidé dans cette nouvelle saison de l’Institut ?
La volonté de répondre aux impératifs de l’Institut, à savoir l’histoire et la civilisation du judaïsme et des monothéismes qui en sont issus, le dialogue interreligieux et la valorisation du patrimoine montpelliérain et occitan.
Comment concilier ce programme avec l’actualité ?
Il faut être à l’écoute du public et de l’actualité, avec le retour de l’antisémitisme et le conflit proche-oriental… On essaie la plupart du temps de solliciter des universitaires, des savants pour dépassionner le débat. Comme Mohammed Ali Amir-Moezzi, un homme d’ouverture, qui fait autorité sur le Coran et l’Islam, et évoquera Mahomet. Ou comme Annette Becker, une des grandes spécialistes de la Seconde Guerre mondiale en France, à l’occasion des 80 ans de la libération du camp d’Auschwitz. Elle évoquera aussi Marc Bloch, qui va être panthéonisé. Nous accueillerons Elie Korchia, président du Consistoire, pour parler des défis de la communauté juive française. Il abordera d’ailleurs le projet muséal autour de l’histoire des juifs du Languedoc que nous avons avec la Ville. Patrick Klugman, avocat et président du Comité français pour Yad Vashem, qui est un progressiste, parlera de l’antisémitisme. Yan Jurovics viendra nous repréciser la notion de génocide, parce qu’il y a une grande souffrance à ce sujet chez les Palestiniens et chez les Israéliens.
D’où vient le manque de tolérance et de dialogue, aujourd’hui ?
On veut aller trop vite, on n’approfondit pas, on lit moins, on croit tout savoir alors qu’on ne sait rien. On progresse en science mais humainement, on régresse. Au Moyen-Âge, il y a eu des formes rigoristes. Mais il y a aussi eu des gens qui avaient 50 ans d’avance, qui avaient tort d’avoir raison trop tôt. C’est le cas d’Averroès et Maïmonide. Le monde d’aujourd’hui manque de personnes emblématiques comme celles-là, de gens de paix, au Proche-Orient mais pas seulement.
Maïmonide disait qu’il faut être ouvert et tolérant.
C’est ce qui a fait la force de Montpellier au Moyen Âge
Comment avez-vous vécu ces deux années de conflit au Proche-Orient ?
C’est une souffrance de voir deux peuples s’entredéchirer, alors qu’ils sont condamnés à s’aimer. Il faudra voir sous quelle forme ils vont réussir à faire la paix. La flambée de l’antisémitisme en France, en Europe et dans le monde m’attriste. Surtout depuis le 7 octobre. Quand l’antisémitisme sort de sa boîte, c’est très dur de revenir en arrière.
Que pensez-vous des appels au boycott du jumelage entre Montpellier et Tiberiade ?
Ceux qui le demandent méconnaissent l’histoire juive. Tibériade est une des quatre villes saintes du judaïsme dans la Bible. Montpellier était aussi une ville sainte du judaïsme au Moyen-Âge. Il faut aussi savoir que Maïmonide, qui a enseigné à la fac de médecine de Montpellier, est enterré à Tiberiade. Ce jumelage existe pour différentes raisons, mais aussi parce qu’il y a ce lien judaïque. On ne va rien résoudre en cassant ce jumelage. C’est un peu comme le 7 octobre, où le Hamas s’en est pris à des gens de gauche qui aidaient les Palestiniens. C’est en construisant des passerelles et pas en détruisant qu’on va avancer ensemble. Michaël Delafosse a bien fait de défendre ce jumelage.
Bio express
Né à Gardanne en 1973, Michaël Iancu est arrivé à Montpellier en 1984. Il y a fait ses études et est diplômé d’un doctorat en histoire. En parallèle, il a suivi des cours de violon au conservatoire.
Dans les années 90, il a créé le Centre d’information pour la paix au Proche-Orient. Il préside l’Union des étudiants juifs de France à Montpellier.
Maître de conférences à l’Université de Cluj (Roumanie) de 2006 à 2012, chercheur associé au CRISES de Montpellier 3, il est l’auteur de nombreux ouvrages.
Il dirige l’Institut Universitaire Maïmonide-Averroès-Thomas d’Aquin depuis 2000. Il est enfin délégué régional du Comité français pour Yad Vashem (institut international pour la mémoire de la Shoah) depuis 2010.
Avez-vous de la famille en Israël ?
Oui, chaque fois qu’il y a la guerre, on tremble pour eux parce qu’ils sont en première ligne. Eux n’aspirent qu’à une chose, la paix.
D’où peut venir la paix aujourd’hui ?
Avec le Hamas, il n’y a rien à faire. Parce qu’à partir du moment où ils disent « Dieu a dit ceci », c’est terminé. Ça nous rappelle que ce conflit est essentiellement religieux. Avec Netanyahou, c’est compliqué. On est très loin d’Yitzhak Rabin, qui avait apporté un véritable espoir de paix. Et on est loin d’Elie Barnavi (historien et ancien ambassadeur d’Israël en France), que j’avais reçu et qui est un farouche détracteur de Netanyahou. Aujourd’hui, il y a un petit espoir, parce que les armes se sont tues. Mais il y a une telle haine de part et d’autre que le chemin sera très long.
On en revient à Maïmonide et à Montpellier…
Oui, Maïmonide disait qu’il ne faut pas avoir peur du monde qui nous entoure. Sinon, ça veut dire qu’on n’est pas sûr de sa foi, de son judaïsme en l’occurrence. Il faut être ouvert et tolérant. C’est aussi ce qui a fait la force de Montpellier au Moyen-Âge, ce qui lui a permis de devenir une ville universitaire de tolérance, de savoir et d’échange.