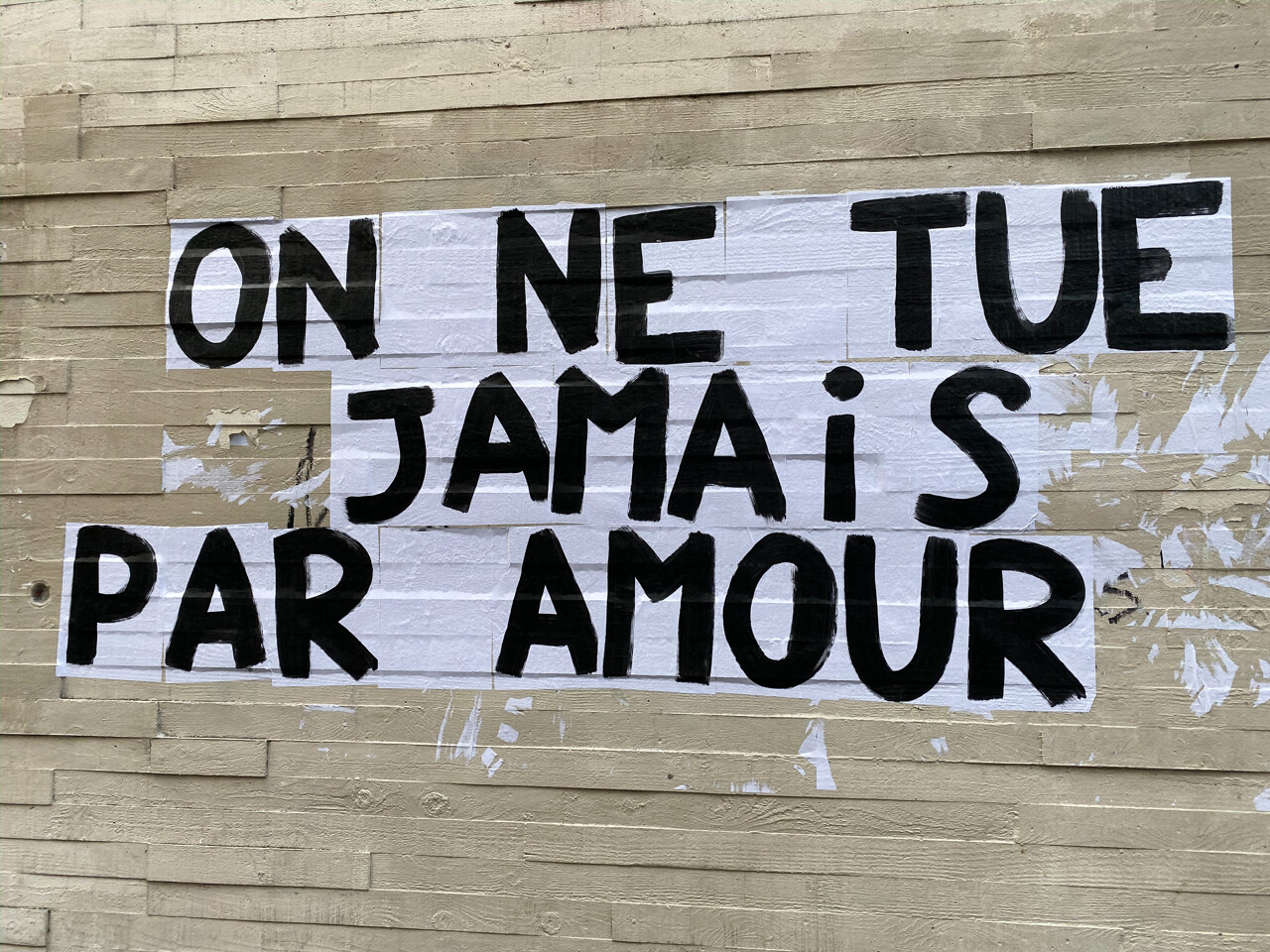Par
Sophie Vincelot
Publié le
27 oct. 2025 à 21h07
Il ne se passe pas une semaine sans que les rédactions locales d’actu.fr s’en fassent l’écho. Des femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, ou encore disparues dans des circonstances inquiétantes. Il y a quelques jours, une jeune adolescente de 15 ans a été retrouvée morte dans un hôtel à Lille. Son petit ami, qui s’est rendu au commissariat, a avoué l’avoir tuée. Plus tôt dans le mois, c’est le corps sans vie de Sandrine qui a été découvert à son domicile, dans l’Eure. La victime pourrait avoir succombé aux violences de son mari.
Début septembre, le meurtre d’Inès Mecellem par son ex-compagnon à Poitiers a créé un émoi national, alors que la jeune femme avait porté plainte à plusieurs reprises contre lui et que celui-ci avait été interpelé puis relâché. Autant de drames qui viennent alourdir le bilan dressé par le collectif #NousToutes, qui recense 131 féminicides depuis le début de l’année 2025. Un chiffre qui approche de celui de l’année précédente, où 141 meurtres ont été comptabilisés.
D’ailleurs, mi-octobre, la Fédération nationale des victimes de féminicides (FNVF) a tiré la sonnette d’alarme, faisant état de huit meurtres de femmes en seulement 10 jours. Alors que vient de se clore le procès de Cédric Jubillar, condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle en première instance pour le meurtre de sa femme Delphine, les associations, familles et avocats dénoncent encore un déni de la France autour de la question des féminicides.
C’est le cas de Me Isabelle Steyer, avocate en droit pénal et droit de la famille, qui accompagne depuis plus de 30 ans les victimes de violences sexuelles et les familles de victimes de féminicides. Elle a notamment représenté la famille de Nathalie Debaillie, tuée par son ex-compagnon et trois complices, après avoir fait plusieurs signalements à la police restés sans suite. Affaire dans laquelle l’État a été condamné en juin dernier pour « faute lourde ». Interview.

Me Isabelle Steyer, avocate en droit pénal et droit de la famille, accompagne les victimes de violences sexuelles et les familles de victimes de féminicides. (©DR)
Actu : Les associations tirent la sonnette d’alarme sur le nombre de féminicides qui ne baisse pas, voire risque d’augmenter en 2025. Pourquoi n’arrive-t-on pas à inverser la courbe ?
Isabelle Steyer : On ne s’attache pas à la protection des femmes. Quand elles viennent dire qu’elles sont en danger de mort, on ne les écoute pas. On ne veut pas comprendre le phénomène des féminicides, alors qu’il est finalement très connu. Quand certains hommes n’acceptent pas une séparation, ils deviennent de plus en plus violents. Ils harcèlent, suivent et attaquent. Les femmes ont beau déposer plainte, elles n’ont souvent pas de réponse. Ou sinon, c’est bien trop tardif.
Il y a à la fois un laxisme et une absence d’appréhension du phénomène. La problématique des violences sur les femmes et les enfants est très importante. Pourtant, il y a un déni massif, pour des raisons politiques différentes. En réalité, c’est un débat qui ne devrait pas être politisé. N’importe quel homme, qu’il soit sous OQTF [obligation de quitter le territoire français, NDLR.] ou issu de la grande bourgeoisie, peut être violent. Les violences sont massives, qu’importe les classes sociales.
Les chiffres annoncés par les associations sur les féminicides sont même en-deçà de la réalité, car il y a également des suicides forcés, mais aussi certains accidents suspects.
Me Isabelle Steyer
Plusieurs victimes de féminicides ont signalé auprès de la police ou de la justice les violences qu’elles subissaient de la part de leur compagnon ou ex-compagnon, avant d’être tuées. Pourquoi n’ont-elles pas été protégées ?
I.S. : Une accumulation de mythes entoure les femmes. Il y a celui de la menteuse, de l’hystérique, de la manipulatrice, de la profiteuse, de la mère fusionnelle qui veut avoir la garde exclusive de ses enfants ou encore de la femme qui veut gagner de l’argent. Tout cela s’ajoute à une absence de connaissances, de temps, de lien entre la plainte et la prévention.
Votre région, votre actu !
Recevez chaque jour les infos qui comptent pour vous.
D’ailleurs, pour que l’on comprenne bien la portée du mot « féminicide », pouvez-vous nous dire ce qu’il recouvre exactement ?
I.S. : Le terme de féminicide n’est pas inscrit dans le Code pénal. De fait, on peut l’interpréter comme on veut, puisqu’il n’y a pas de définition légale. Ce que l’on peut dire, c’est que ce terme, qui évoque le meurtre d’une femme parce qu’elle est une femme, est venu se substituer aux notions de crime passionnel et de crime pulsionnel. Il n’y a ni passion, ni pulsion quand on tue une femme. Le mot de féminicide permet de voir que la femme peut être victime en fonction de son genre.
Il y a eu plusieurs féminicides très marquants. Début septembre, Inès Mecellem, avant son meurtre, a déposé plainte à plusieurs reprises et utilisé un téléphone grave danger. Son ex-compagnon, qui l’a tuée, a même été interpelé deux jours avant son meurtre mais relâché immédiatement. Les outils mis à disposition des femmes victimes de violences sont-ils réellement efficaces ?
I.S. : Les femmes victimes de féminicides font souvent tout ce qu’il faut. Elles déposent plainte, tentent de se protéger. Elles ne vont pas menacer les hommes qui les harcèlent. Certaines sont même accompagnées. En réalité, il faudrait distribuer de manière quasiment systématique un bracelet anti-rapprochement [dispositif de surveillance électronique qui permet de géolocaliser une personne à protéger et un auteur réel ou présumé de violences conjugales, NDLR.] quand on soupçonne des violences.
Le « téléphone grave danger » (TGD) n’est pas toujours suffisant. Les femmes ont beau s’éloigner, se barricader chez elles ou sur leur lieu de travail, ce n’est pas assez.
Quand les hommes harcèlent, il faut les mettre en examen, les placer sous contrôle judiciaire. Le problème, c’est qu’il n’y a jamais de poursuite en cas de harcèlement.
Me Isabelle Steyer
Sous-estime-t-on trop la dangerosité de certains individus ? Y a-t-il aussi une forme de laxisme de la justice quand il s’agit de violences perpétrées à l’encontre de femmes ?
I.S. : On peut dire que 100 % des femmes ont été victimes de VSS [violences sexistes et sexuelles, qui peuvent aller d’un harcèlement sexuel au féminicide, en passant par la discrimination à l’embauche, l’agression sexuelle et le viol, NDLR.]. Pourtant, quand les femmes portent plainte, elles ne sont pas crues, et ce même quand il y a des éléments probants. Les taux de classements sans suite s’élèvent à 86 % dans les affaires de violences sexuelles, et même plus de 90 % pour les viols.
Vous-même, vous avez représenté des familles de victimes de féminicides (Éléonore Places, tuée en 2022 et Nathalie Debaillie, assassinée en 2019). Comment aborde-t-on ce type de dossiers ?
I.S. : Ce sont des dossiers très compliqués. Car j’ai envie d’expliquer que ces femmes ont à la fois été victimes de leur conjoint, mais aussi des institutions. Le problème, c’est que quand je dis qu’elles sont victimes des institutions, cela banalise presque ce qu’a fait leur meurtrier. Elles sont à nouveau les victimes d’une absence de liberté de parole et de choix stratégiques pour essayer de dénoncer « au bon endroit ». Les hommes violents, quant à eux, se disent toujours victimes, évoquent des syndromes post-traumatiques pour justifier leur violence.
Le procès de Cédric Jubillar, condamné en première instance pour le meurtre de Delphine Jubillar, est-il une forme de tournant ? Il n’a jamais avoué et l’on n’a pas retrouvé le corps de son épouse. La justice s’est fondée sur un faisceau d’indices pour le condamner.
I.S. : Je ne sais pas si c’est un tournant, mais ce procès montre que l’on a changé de point de vue sur les femmes qui disparaissent. Une femme, qui a un travail, des enfants, et un projet de vie, à savoir quitter son mari pour son amant, ne disparaît pas comme ça. La mythologie, selon laquelle une femme disparaît parce qu’elle veut fuir sa vie et partir à l’autre bout du monde, a longtemps existé.
Dans le cas de l’affaire des disparues de l’Yonne ou même de l’affaire Michel Fourniret, de jeunes femmes ou filles disparaissaient et la police ne partaient pas à leur recherche. Pour Fourniret, il a même fallu que les familles se battent. Désormais, avec le terme de féminicide, on interprète différemment ces disparitions. On regarde du côté du compagnon, ou d’un rôdeur, par exemple, qu’elles auraient pu rencontrer.
Toutefois, il y a une lacune dans le dossier de Cédric Jubillar, car il n’a pas été suspecté immédiatement. Il s’est même constitué partie civile pour avoir accès au dossier et savoir ce que les policiers faisaient.
Les coupables de féminicides finissent-ils par se rendre compte de ce qu’ils ont fait ?
I.S. : Dans nos dossiers, les hommes violents reconnaissent rarement ce qu’ils ont fait. J’ai eu le cas d’un homme qui a inventé une histoire, selon laquelle sa femme a été tuée par un autre homme qui a pénétré dans leur studio de 35 m², alors que lui même était présent et que celui-ci se serait caché pour se protéger de l’intrus. La femme voulait le quitter parce qu’il lui interdisait de sortir et de travailler.
Ces hommes ont une vraie volonté d’asseoir leur pouvoir. En plus, ils ne sont pas démentis dans leur famille, ils sont même parfois traités comme des dieux. L’affaire Jubillar est un cas assez unique parce que la mère de Cédric Jubillar n’a pas soutenu son fils, et s’est rangée du côté de la victime.
Ce qui est sûr, c’est que du côté des agresseurs, il y a une forme d’imperméabilité, voire un dénigrement du féminin. Finalement, tuer une femme est comme tuer un être inférieur.
Me Isabelle Steyer
Le droit pénal en France est-il réellement adapté aux femmes ?
I.S. : Si ce droit était adapté aux femmes, je ne serais pas descendue dans la rue pour le changer. Les peines pour des violences faites aux femmes dépassent rarement les six mois de sursis. Il y a un taux de classement sans suite effarant, parce que l’on met régulièrement en cause la parole des victimes. Ce taux s’élève tout de même à 75 % en cas de violences conjugales. Souvent, la femme cherche à obtenir la paix, alors que l’institution et la société lui assignent toujours de mauvaises intentions. On ne pense pas qu’un homme que l’on connait puisse tuer, taper ou violer. On s’imagine que c’est toujours l’autre.
Peut-on parler d’une justice à deux vitesses concernant les femmes ?
I.S. : On a trop de classements sans suite. Il faudrait que les enquêtes soient faites. Dans beaucoup cas, il y a déjà eu d’autres violences : verbales, professionnelles, sexuelles. Un homme accusé a souvent déjà été violent à d’autres occasions. Il faut chercher, et si l’on ne cherche pas, en effet, on ne retrouvera rien.
Les dossiers sont toujours construits à décharge et a minima. Au lieu de condamner un homme et d’éviter que l’on fasse d’autres victimes, on donne un blanc-seing [ autorisation écrite donnée à quelqu’un pour agir librement en son nom, souvent sans restriction ni contrôle, NDLR.] à des hommes, sur qui il n’y a pas d’investigation, ni d’expertises réalisées. Ils restent libres et cela vient créditer le faire que l’on peut taper ou violer des femmes. Si l’on ne veut pas poursuivre, il faut mettre en place des mesures alternatives pour protéger les femmes. L’institution est souvent très mobilisée pour protéger l’agresseur, rarement la victime.
On encourage les femmes à dénoncer les violences qu’elles subissent. Pourtant, une partie d’entre elles dénonce un retour de bâtons violent, notamment quand il s’agit de dénoncer des violences dans la sphère professionnelle ou familiale. En quoi cela participe-t-il à une « silenciation » des femmes ?
I.S. : On demande aux femmes de parler, mais en faisant cela, elles se mettent en danger elles et leur famille. De plus, il y a une peur de la procédure bâillon [instrumentalisation de la justice par les accusés pour faire taire les victimes, ndlr] et puis des procédures avec des délais à n’en plus finir. C’est quelque chose de très compliqué à vivre. On est dans des situations d’inversion, où la femme, pour être reconnue victime, doit être parfaite, comme Gisèle Pelicot qui a dû lisser son image. Sinon, elle ne sera pas crue. Aussi, on ne prend jamais en compte le syndrome post-traumatique que les victimes subissent.
On peut être acariâtre et victime de violences conjugales, voleuse et victime de viol. Il n’y a pas de victime parfaite.
Me Isabelle Steyer
Faut-il prendre exemple sur l’Espagne, qui a réformé en profondeur la manière de juger les VSS et qui condamne réellement les agresseurs ?
I.S. : C’est un système qui fonctionne mieux que la France. Même si les Espagnols sont encore critiques par rapport à leur modèle, car cela n’a fait baisser que d’un tiers le nombre de féminicides. Cela montre à quel point la mobilisation doit être immense pour que ça change réellement.
En 2017, Emmanuel Macron a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes la « grande cause de son quinquennat ». Huit ans après, quel bilan peut-on tirer de son action ?
I.S. : Quand on a un Président qui défend Gérard Depardieu, pourtant accusé de viols et d’agressions sexuelles, cela annonce la couleur. Sans compter le fait que l’on a nommé au ministère de l’Intérieur, puis de la Justice, un homme qui a été accusé de viol, même si cela a abouti à un non-lieu. Ce sont des symboles forts, qui montrent un véritable désintérêt pour cette cause. On est sur un mensonge, voire une escroquerie des politiques à l’égard des femmes.
Personnalisez votre actualité en ajoutant vos villes et médias en favori avec Mon Actu.