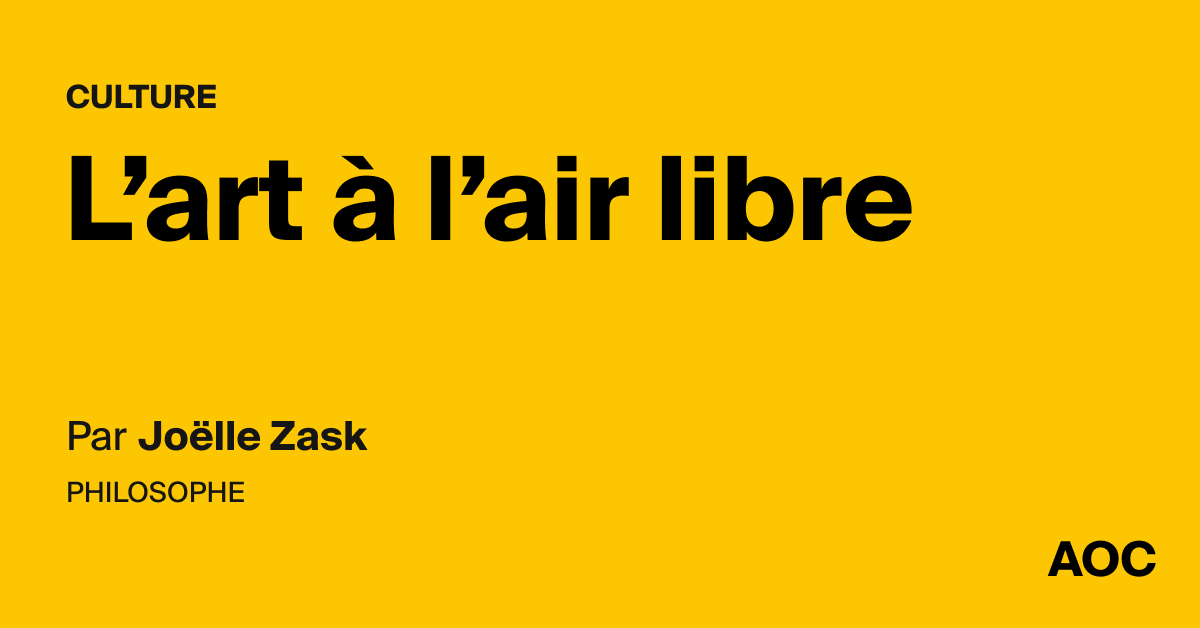L’art à l’air libre
On se souvient de la polémique du Bouquet de tulipes de Jeff Koons, qui pose la question de ce que l’on cherche en installant des œuvres d’art dans l’espace public des villes. Font-elles de nous des participants à la vie de nos environnements ou nous réduisent-elles à de simples spectateurs, parfois en colère, mais pas engagés dans la création de nos propres conditions d’existence ?
Nos villes sont pleines de sculptures et de monuments que, la plupart du temps, nous ne remarquons pas. Comme l’avait noté l’écrivain Robert Musil, il nous est plus naturel de repérer une pièce de 10 centimes coincée au sol entre deux pavés qu’une sculpture monumentale dont pourtant la facture, la masse, la situation souvent centrale, visent à forcer l’attention.
Peut-être en va-t-il de ce type de dispositif comme du mobilier urbain ultra-spécialisé et mono fonctionnel, tel par exemple une chaise étroite boulonnée au sol. Les enquêtes le prouvent : plus les objets éparpillés dans notre environnement sont contraignants, plus ils sont dégradés, ou parfaitement ignorés. La statuomanie qui a caractérisé la IIIe République en vue d’accompagner la solidification de l’État-nation et le développement de l’esprit républicain a abouti à ponctuer nos villes de « statues de grands hommes » qui ne nous disent rien : piédestal, érection, dramatisation, centralisation, imposition d’une symbolique dans laquelle les citoyens ne se reconnaissent pas, emplacement destiné à contraindre la circulation dans un rapport parfaitement scopique qui suppose que toute appréciation, si elle avait lieu, imposerait de se déconnecter des activités auxquelles nous nous adonnons quotidiennement.
En lien avec la longue histoire de la mise en scène du pouvoir politique, ou théâtrocratie, j’ai proposé de réserver l’expression « espaces publics » aux espaces qualifiés par le monumentalisme, l’ostentation, la domination, le primat du visible, l’édification, la symbolisation d’un pouvoir qui cherche suivant les cas à effrayer ou à plaire, l’imposition d’une certaine version de l’histoire, accompagnée de l’effacement de pans entiers de celle-ci, — toute politique de la mémoire s’accompagnant d’une politique de l’oubli.
Serait-ce en raison de notre indifférence à l’égard de tels dispositifs (dont on peut rappeler qu’ils sont hérités de la monarchie absolue et se perpétuent étrangement jusqu’à aujou