Vingt ans après sa sortie, Mystic River demeure un des longs-métrages de Clint Eastwood les plus admirés et populaires. Revenons sur cette exploration mélancolique de l’innocence mutilée.
D’où vient le Mal ? Est-il consubstantiel à l’humanité ? Peut-il être circonscrit ? Sous couvert de narrer une enquête sordide au carrefour de la petite criminalité nord-américaine, des scandales de pédophilie ayant ébranlé l’épiscopat bostonien et des destins brisés de trois enfants, Clint Eastwood se questionne avec Mystic River sur la banalité du mal.
 Trois fantômes pour une tragédie
Trois fantômes pour une tragédie
UNE CITE L’AUBE
À Boston, trois amis d’enfance que la vie a éloignés se retrouvent quand la fille d’un entre eux est assassinée. La tragédie et l’enquête qui en découlent vont réactiver le souvenir d’un trauma plus ancien encore. Voici l’équation funèbre qui régit Mystic River, d’abord roman noirissime de l’écrivain Dennis Lehane, et de son adaptation éponyme par Clint Eastwood. La parenté entre les deux artistes, pour qui a déjà lu les travaux de l’auteur d’Un Pays à l’aube, Shutter Island, Un dernier verre avant la guerre ou Ténèbres, prenez-moi la main, avait tout de l’évidence.
Les textes de Lehane décrivent une Amérique, dont Boston serait le cœur palpitant, minée par la culpabilité et le martyr des plus faibles, où se rencontrent les idéaux, les appétits et les accès de violence, voués à s’entrechoquer dans la fureur. On ne s’étonnera donc pas que le cinéaste qui aura le plus questionné les mythologies américaines, autopsié ses héros et ses salauds, y ait trouvé matière à cinéma. Et si par bien des aspects, la mise en scène, la photographie et le montage de Mystic River annoncent l’esthétique qui dominera l’œuvre d’Eastwood durant les décennies à venir, l’étouffante obscurité qui nimbe le film renvoie en creux aux thématiques d’une de ses premières réalisations.
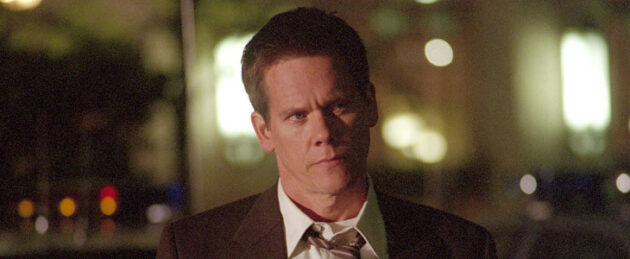 Solitude de l’enquêteur de fond
Solitude de l’enquêteur de fond
En 1973, Clint Eastwood prenait son public à revers avec L’Homme des Hautes Plaines, western flirtant avec l’abstraction et le surnaturel, où un Clint Eastwood spectral feignait de protéger une petite bourgade des bandits la rackettant, pour mieux faire expier à ses habitants un crime passé. Film hanté, fable (a)morale où le cinéaste retournait comme un gant les codes du genre qui l’avait rendu célèbre, il décrivait une Amérique se transformant symboliquement en cercle des enfers aride. C’est à un processus semblable, peut-être plus désespéré encore, que nous assistons avec Mystic River.
Le Sud-ouest américain est remplacé par la capitale du Massachusetts, les plaines brûlées par le soleil sont devenues les ruelles cradingues des quartiers populaires de Boston, et en lieu et place du ciel azuréen écrasant les pêcheurs, c’est la rivière Charles qui donne le la. Scindant la métropole en deux, elle aspire les souvenirs honteux, les traumas, et paraît s’infiltrer dans chaque photogramme éclairé par Tom Stern.
 Au fond du gouffre
Au fond du gouffre
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE
Il tient ici le rôle de chef opérateur pour la deuxième fois de sa carrière, après avoir travaillé des années durant comme électro et technicien sur les films du grand Clint, et façonné l’image de Créance de sang. Sa collaboration de longue date avec le metteur en scène n’est sans doute pas pour rien dans la réussite de Mystic River, qui compte parmi ses métrages les plus plastiquement accomplis.
En témoigne une séquence qui a durablement marqué le public, et demeure aujourd’hui encore emblématique tant du cinéma de Eastwood, que de la carrière de ses interprètes. Il s’agit bien sûr de la scène au cours de laquelle Sean (Kevin Bacon) découvre le corps désarticulé de Jimmy (Sean Penn). Le décor, un des moins urbains du métrage, fait office de point de jonction entre le béton et le fleuve, la nature pourrait y apparaître dense, luxuriante presque, à la faveur des premiers travellings accompagnant le policier jusqu’à la scène de crime. Puis, alors que se succèdent des plans plus serrés, les couleurs s’assombrissent, des teintes anthracite le disputent au vert qui sature l’image.
 Deux hommes aux prises avec des plaies ouvertes
Deux hommes aux prises avec des plaies ouvertes
Eastwood, qui connaît ses classiques, organise, à la faveur d’images aux inspirations picturales évidentes, traite à la fois le tragique et la dimension virale, métastatique, de la violence. Une fois le cadavre découvert surgit Penn, père ivre de tristesse et de rage. Alors qu’il se précipite pour confronter cet ami d’enfance et savoir si c’est bien le corps de sa fille qui a été découvert. Détective et père vont pour se rencontrer, mais sont interrompus, autant par un mur d’officier scindant l’espace en deux, que par la nature des énergies qu’ils dégagent.
Sean est écrasé par l’horreur de la situation, interdit, tandis que Jimmy n’est déjà plus que colère et furie. Leur face-à-face interrompu, impossible, témoigne déjà de ces cercles concentriques de brutalité et de violence qui vont croître pendant tout le film. On pourrait en rester à ce plan zénithal présentant Sean Penn hurlant, la voix brisée et nimbée de larmes, qu’on croirait échappée d’un tableau néo-romantique, mais il n’est pas seulement question pour le réalisateur d’inscrire Mystic River dans une geste esthétique échappée de la peinture de la tragédie. Car ce qui pointe ici et vrille déjà le coeur du spectateur, c’est bien la mélancolie dévorante qui sature l’écran.
 La rage et l’horreur
La rage et l’horreur
LE MAL PAR LE MÂLE
On a volontiers caricaturé le metteur en scène en porte-étendard républicain d’un cinéma volontiers réactionnaire, voire bêtement viriliste. Comme plusieurs de ses films, celui qui nous intéresse vient battre en brèche cette vision incomplète et largement fausse d’Eastwood. En effet, une large partie de sa filmographie aura été consacrée à questionner la notion même de virilité, ses limites, ses impensés, voire sa possible toxicité. Les trois protagonistes de Mystic River présentent tous un rapport complexe à leur masculinité, comme à son affirmation.
Incarné par un Tim Robbins déchirant, Dave est un homme brisé par un crime pédophile, qui mutila son enfance et celle de ses deux amis. Écrasé, tantôt mutique tantôt brutal, il est incapable de communiquer, tout particulièrement avec son épouse, qui ne le comprend pas et croit voir en lui un possible monstre. Sean est un policier quasi mutique, qui ne reconnaît plus sa ville et n’y voit plus qu’un vaste organisme cancéreux dont il doit péniblement amputer les bubons, tandis que son couple se délite, jusqu’à se désincarner tout à fait, sa femme n’étant présente qu’à travers de cruels dialogues de sourds par téléphone interposé.
 Le roi est nu
Le roi est nu
Jimmy quant à lui, joue jusqu’à l’absurde les codes d’une virilité triomphante. Petit caïd affirmant constamment la possibilité de la violence, mais préférant la sous-traiter à ses lieutenants. Tout à fait désorienté, il paraît constamment sur le point de renoncer, d’abandonner, comme si la menace qu’il s’évertuait à représenter le pesait aussi terriblement qu’une croix. Croix dont les derniers clous seront posés dans les ultimes minutes de l’intrigue, à la faveur du monologue ahurissant de Laura Linney.
Personnage en apparence secondaire, elle dévoile, alors que Jimmy, balayé par le meurtre qu’il vient de commettre, qu’elle tire à la perfection les ficelles d’un pouvoir masculin aveugle. Quand elle annonce à Jimmy qu’il est désormais le roi, elle fait tout à fait basculer l’histoire dans la tragédie shakespearienne.
 Le cercle sans fin de la violence
Le cercle sans fin de la violence
Telle une Macbeth aux petits pieds, elle légitime son époux, se sacrant au passage comme l’impératrice de son petit royaume putrescent. Et quand, quelques secondes plus tard, Sean Penn se retire tout à fait du monde, enfilant la panoplie – le costume dirait-on – du criminel de cinéma et des lunettes de soleil qui le précipitent dans l’obscurité, Eatswood nous dit bien que la rivière mystique du titre est un marécage. Un lieu qui retient les fautes, les péchés et les souffrances, les condamnant à ressurgir à la manière d’alluvions maudites.
« Nous étions enfermés tous les trois dans cette cave », explique alors Sean, scellant tout à fait le destin des personnages, et de la ville. On ne revient pas de l’horreur, et on ne peut jamais atteindre la résilience. C’est ce déterminisme terrible, ce portrait impitoyable de victimes qui se transforment inexorablement en bourreau, sinon en boucher, qui fait de Mystic River une des plus grandes œuvres sur l’irrémédiable noirceur du monde.
